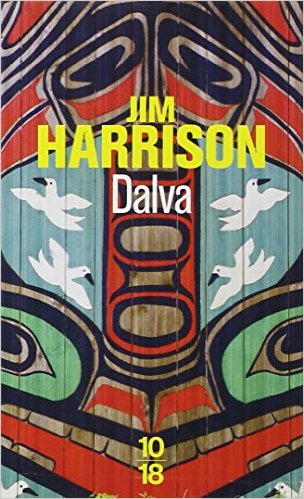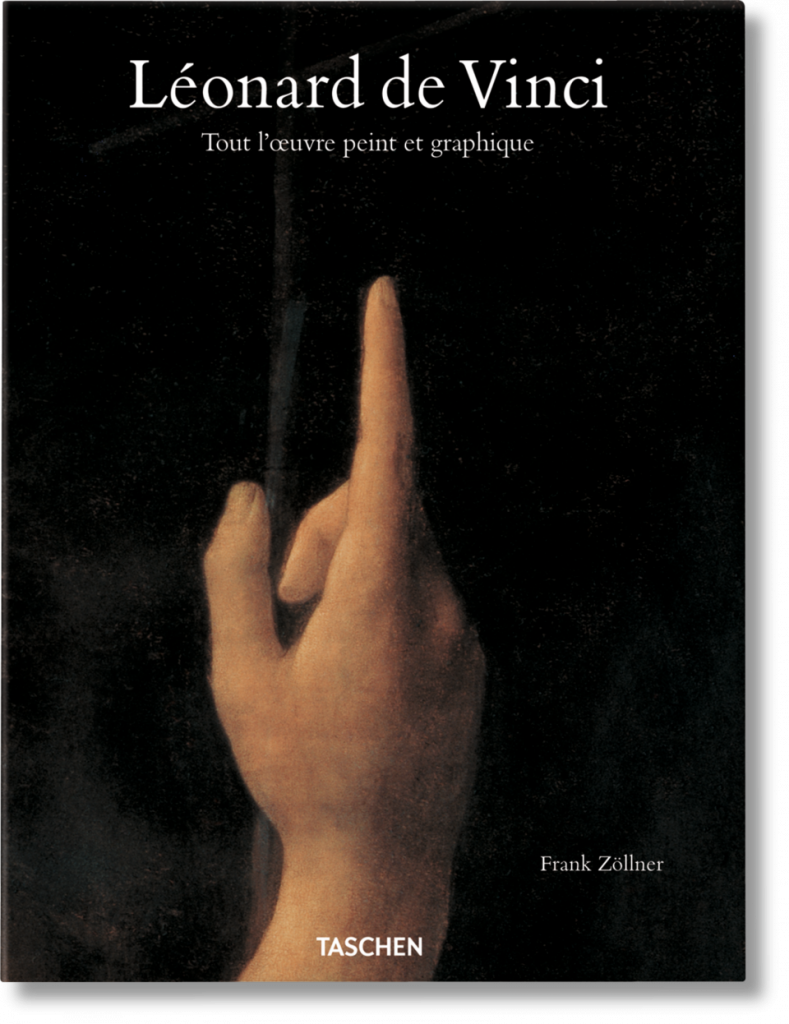Si l’ordinateur remplace avantageusement la machine à écrire – nous n’en disconviendrons pas – le stylo et le papier n’en restent pas moins des outils nécessaires aux forçats de l’écriture. Les jeunes gens qui enregistrent un entretien d’une heure sur un smartphone ont tôt fait de comprendre que rien ne remplace une bonne prise de notes. Et l’on est autorisé à sourire lorsqu’un ami annonce avoir perdu l’ensemble de ses contacts, engloutis corps et biens dans le naufrage d’un téléphone ou d’un micro-ordinateur, faute de disposer d’un bon vieux carnet d’adresses. J’adore les moments où il faut renouveler la panoplie et se doter de nouveaux outils pour l’année à venir. La mise à contribution de quelques boutiques indiennes aura décuplé le plaisir cette année. Petite revue de détail.
Il y a pour commencer le cahier du dehors, sur la gauche de la photo. Un cahier anglais, solide, bien relié et payé assez cher confessons-le, destiné à la prise de notes lors de rendez-vous extérieurs. Un cahier un peu habillé, pour sortir en ville. Au centre, une super trouvaille, débusquée dans une minuscule papeterie de Guruvayoor : un note book fabriqué en Inde, solide, également, ligné mais non daté. C’est le pense-bête où s’inscrivent chaque matin les tâches à effectuer dans la journée, où quelques idées sont notées à la volée.
Les idées plus construites, les projets, les notes appelées à être retrouvées plus facilement sont elles destinées au cahier qui se tient debout. C’est l’acquisition majeure de cette rentrée, un superbe cahier relié toilé, divisé en cinq parties séparées par des intercalaires colorés, lui aussi débusqué en Inde pour quelques roupies. La principale difficulté lorsque l’on conduit plusieurs chantiers de front est de ne pas retrouver ses petits lorsqu’on les recherche. Entre le programme du festival des 3 continents, la préparation d’un débat sur la mobilité connectée ou l’implantation d’une fnac à Saint-Nazaire, il vaut mieux éviter la confusion. Entre deux s’est discrètement glissé l’agenda de la pléiade, avec son répertoire amovible que l’on récupère chaque année. Pas de commentaire, c’est le classique des classiques avec sa reliure de cuir qui s’assouplit au fil de l’an.
Magnifique trouvaille aussi que celle des stylos billes indiens placés au centre (la plume est exclusivement attachée au bureau, Waterman n’oublions pas). Ce sont des genres de Bic qui auraient été croisés avec des feutres à pointe fine. D’un confort d’écriture absolu pour un prix dérisoire… moins d’un euro les dix, j’en ai pris deux pochettes étant un incorrigible paumeur de stylos devant l’éternel.
Enfin, le bricolage de l’année pour les prises de notes lors d’entretiens au téléphone, grandes consommatrices de papier. C’est le rayon recyclage du dispositif. Sur un support de bloc acquis à, Barcelone (en cuir, un petit peu chic c’est vrai), je recycle les feuilles imprimées sur une face, stockées dans un tiroir du bureau, je les coupe en deux et les relie avec une barrette servant à solidariser les dossiers. Il suffit de renouveler le blocs toutes les semaines. C’est du papier recyclé gratuit, qui n’a pas vocation à être conservé.
Notons enfin le dernier petit carnet, indien lui aussi, dévolu aux notes de lecture. Lesquelles se retrouvent parfois reportées ici. Pour l’heure il y a un peu de travail : la biographie de Levi-Strauss par Emmanuelle Loyer est passionnante, mais quel pavé.
Bonne semaine