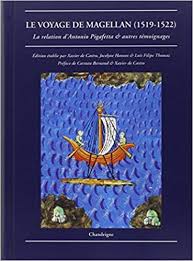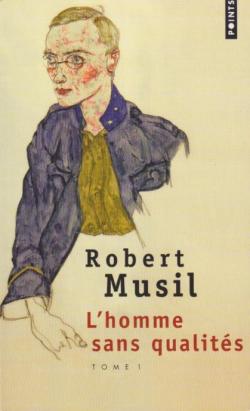“Pauvreté endémique” les premières lignes d’un récent papier du Monde reçu de mon amie Catherine ne dérogent pas au cliché qui colle à la peau de Mayotte, cette poussière d’Empire, où j’achève un séjour de trois mois – dans le centre et sur la côte ouest de l’île. Ce n’est évidemment pas faux, mais c’est un peu plus “un peu plus compliqué que ça” comme dirait François Morel. Quelques lignes donc pour proposer un regard un peu moins caricatural qu’il ne semble l’être dans les rédactions parisiennes et plus généralement en France métropolitaine (sachant que je n’ai pas accès au papier complet du Monde).
Tout d’abord Mayotte est un site naturel exceptionnel, une des îles les mieux loties de l’Océan Indien, qui joue dans la catégorie des Seychelles et de Zanzibar. L’hyppocampe que forme l’île est ceinturé par une double barrière de corail où prospère une faune remarquable : des tortues géantes qui viennent lécher les plages et une variété de poissons peuplant les coraux que l’on peut observer à loisir à fleur de surface. Le littoral est peu accessible, les plages ne sont pas aménagées, il y a un peu de pollution superficielle (essentiellement des déchets) mais pas de problème systémique en raison de l’absence d’industrie. C’est un vrai vrai bonheur pour qui accepte de dévaler quelques pentes pour gagner les plages. L’absence de tourisme participe sans doute de la préservation de ce cadeau de la nature, de ces plages bordées de cocotiers où l’eau est translucide. Sur terre, ou plutôt dans les airs, les makis, ces lémuriens fantasques assurent l’ambiance en familles.
Mayotte est aussi l’île des épices et des parfums, de la vanille de l’Ylang-Ylang. Guerlain y a longtemps possédé d’importantes plantations avant de partir pour les Comores. C’est plus généralement le sanctuaire d’une agriculture ancestrale, intelligente, qui conjugue sur une même parcelle des cultures étagées, tenant compte de la lumière et de l’humidité, patate douce, plants d’ananas, pieds de bananiers, le tout entouré de cocotiers, de manguiers ou de jacquiers. Ce type d’agriculture est malheureusement en déclin mais l’île produit elle-même atour de 70% de ses besoins alimentaires. Rares sont les régions qui peuvent en dire autant.
L’île est officiellement peuplée de 250 000 habitants, mais dans les faits on s’accorde à penser qu’il y en a le double. Des résidents sans papiers, pour la plupart Comoriens, attirés par les lumières de Mayotte et le niveau de vie extravagant à leurs yeux des Mahorais (les natifs de Mayotte) intégrés, et des Métropolitains, pour la plupart enseignants, policiers, infirmières ou médecins, bénéficiant de salaires supérieurs de 40% à ceux pratiqués en métropole. La France et l’Europe tentent ainsi de s’acheter la paix sociale dans ce territoire isolé, au large de Madagascar.
Le résultat de cette politique (la départementalisation a dix ans) est assez étrange. D’un côté l’île est sillonnée de gros 4X4, tous plus rutilants les uns que les autres, les maisons luxueuses poussent à grande vitesse, les équipements se multiplient. Et de l’autre les bidonvilles se déploient, les cases en tôle colonisent les abords des villes, où des dizaines de milliers de résidents sans papiers tentent de survivre en échappant aux contrôles. Le paradoxe est que ce sont eux qui font tourner l’île, notamment l’agriculture et le bâtiment. Payés à coup de lance-pierre (une femme de ménage touche de l’ordre de 150€ au noir), ils sont en quelque sorte le petit personnel de la communauté.
L’une des clefs de compréhension de cette situation est, comme bien souvent, liée à l’histoire du lieu. Mayotte semble avoir été, avant d’avoir choisi son rattachement à la France, la moins considérée des quatre îles qui composent l’archipel des Comores (lequel ne reconnait toujours pas le démantèlement politique de l’ensemble). Cela pour des raisons qui, honnêtement, m’échappent, liées aux différences de culture entre les îles. Ce retournement de fortune explique en partie les tensions qui opposent les communautés, et le côté hyper nationaliste des Mahorais, qui votent volontiers Rassemblement National et considèrent que le gouvernement français est beaucoup trop laxiste en terme d’immigration clandestine.
La natalité galopante (la maternité de Mamoudzou est la plus importante de France, plus de 10 000 naissances par an), l’application du droit du sol aux enfants nés sur l’île de parents étrangers, participent d’une situation sociale explosive, en raison notamment de la présence de centaines d’enfants et d’adolescents livrés à eux-mêmes, qui n’ont d’autre ressource pour vivre que de ramasser les miettes du festin, voire de se servir (les maisons sont dotées de portes métalliques et de grilles). Pendant le confinement, le lycée agricole de Coconi était pillé pratiquement toutes les nuits par des voleurs de poules ou de canards, qui cherchaient tout simplement à manger, faute d’activité.
L’île n’en est pas moins un paradis tropical, où se superposent, sans souvent se recouvrir, les cultures africaines, malgaches, indiennes et européennes. L’une de ses particularités est la culture matriarcale : ce sont les femmes qui possèdent le patrimoine, et elles se le transmettent entre femmes. Cela n’empêche pas, dans cette île musulmane à 98% – un islam africain, assez doux – la pratique de la polygamie. Avoir plusieurs femmes est encore un signe extérieur de réussite, comme posséder une grosse voiture.
Il faudrait, naturellement beaucoup plus de temps prétendre comprendre les enjeux, pénétrer les mystères de cette mosaïque singulière qui s’est construite depuis deux siècles dans un rapport ambigu à l’Occident et à la France en particulier. Mais la réduire à un caillou souffrant d’une pauvreté endémique, secoué par une violence perpétuelle, est une représentation plus qu’abusive. C’est une île plaisante à découvrir, peuplée de gens charmants quand ils sont de bonne humeur, pour qui apprécie la nonchalance africaine et n’est pas trop effrayé par l’humidité tropicale, les petites bêtes, et l’imprésivibilité des évènements.