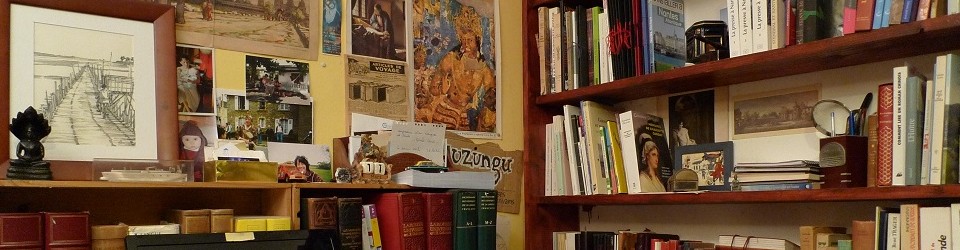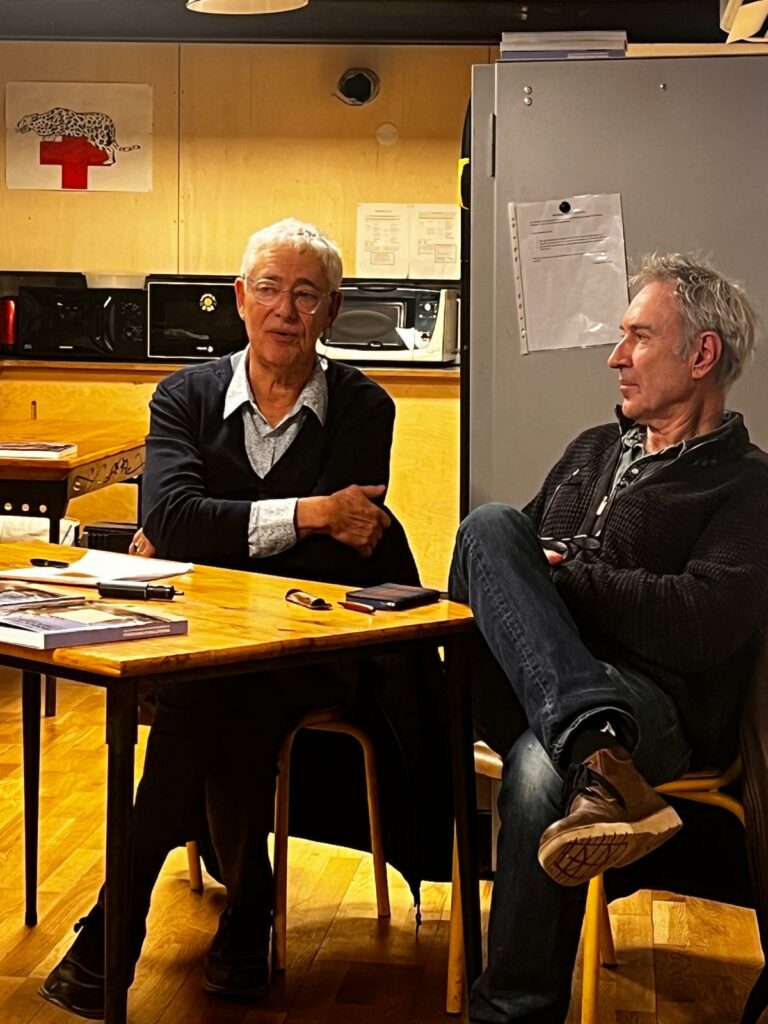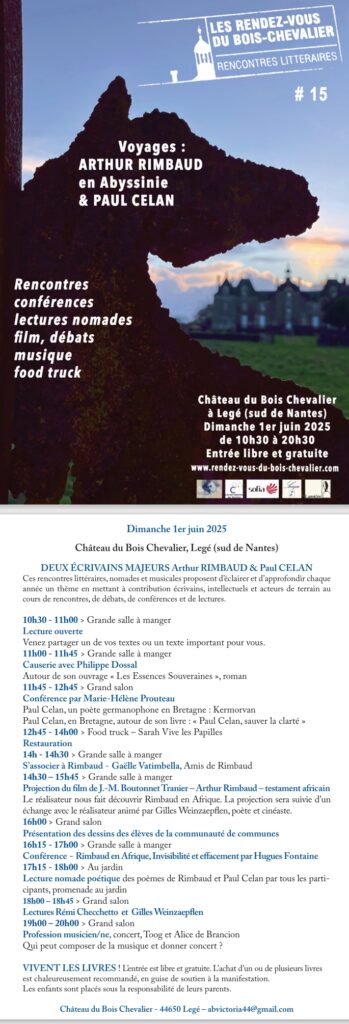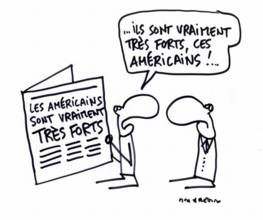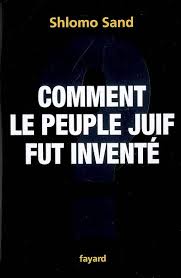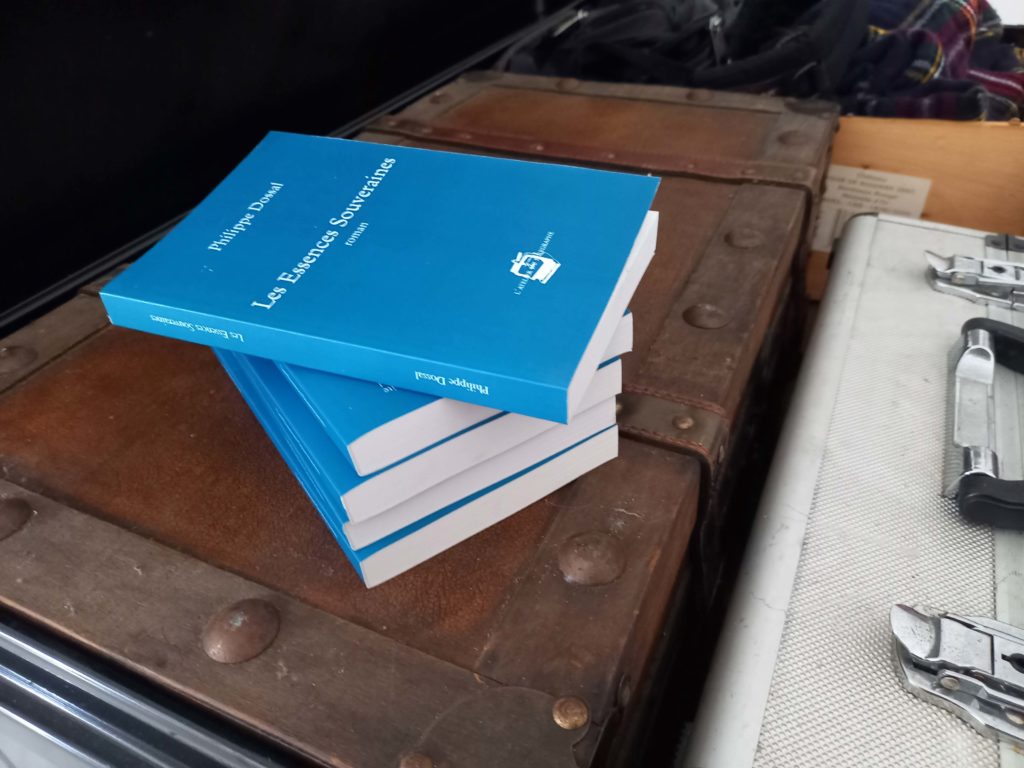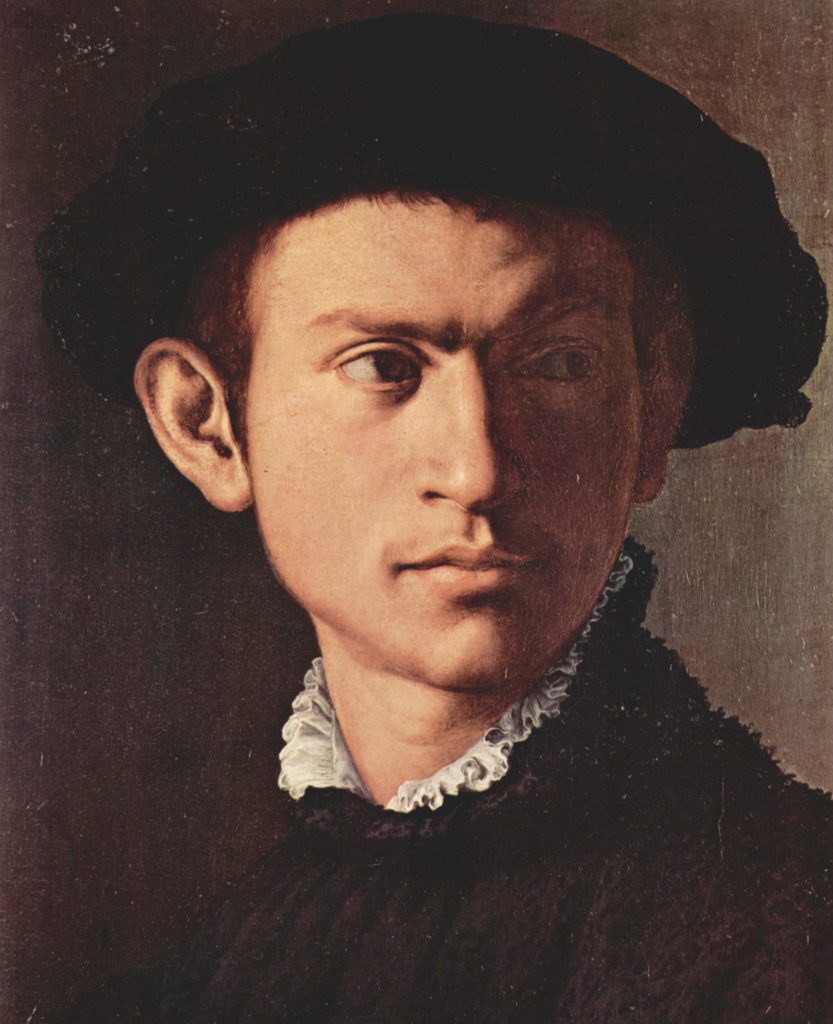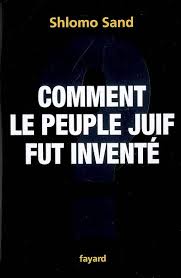 Tout le monde s’est, sans doute, posé la question un jour ou l’autre : comment un peuple a-t-il pu vivre en exil durant deux mille ans, dispersé sur trois, puis cinq continents, en conservant, son homogénéité culturelle, religieuse et …ethnique* ? Seul, sans doute, un historien israëlien était en mesure se lancer dans une telle recherche sans prendre le risque d’être taxé d’antisémitisme. Comme le souligne l’auteur de cet essai, Shlomo Sand, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tel Aviv « l’histoire n’en est pas à une ironie près : il fut un temps en Europe où celui qui affirmait que les juifs, du fait de leur origine constituaient un peuple étranger était désigné comme antisémite. Aujourd’hui, a contrario, qui ose déclarer que ceux qui sont considérés comme juifs dans le monde ne forment pas un peuple distinct ou une nation en tant que telle se voit immédiatement stigmatisé comme « ennemi d’Israël ».
Tout le monde s’est, sans doute, posé la question un jour ou l’autre : comment un peuple a-t-il pu vivre en exil durant deux mille ans, dispersé sur trois, puis cinq continents, en conservant, son homogénéité culturelle, religieuse et …ethnique* ? Seul, sans doute, un historien israëlien était en mesure se lancer dans une telle recherche sans prendre le risque d’être taxé d’antisémitisme. Comme le souligne l’auteur de cet essai, Shlomo Sand, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tel Aviv « l’histoire n’en est pas à une ironie près : il fut un temps en Europe où celui qui affirmait que les juifs, du fait de leur origine constituaient un peuple étranger était désigné comme antisémite. Aujourd’hui, a contrario, qui ose déclarer que ceux qui sont considérés comme juifs dans le monde ne forment pas un peuple distinct ou une nation en tant que telle se voit immédiatement stigmatisé comme « ennemi d’Israël ».
Pas facile donc de traiter d’un tel sujet. Et pourtant cet essai, au titre provocateur, est absolument passionnant. Il montre, avec méthode et brio (le livre est fort bien écrit), disséquant un à un tous les aspects de la question, que le peuple juif est, au même titre que le peuple français ou le peuple allemand, le fruit d’une construction assez récente, parallèle à la montée des nationalismes en Europe au XIXème siècle. Chacun sait que la canonisation de nos ancêtres Gaulois remonte, en gros, à la IIIème république, à cet élan de romantisme national qui a enflammé la France et l’Europe. La chose était un peu plus difficile pour le peuple juif, en raison d’une absence d’homogénéité linguistique et territoriale, c’est pourquoi l’histoire officielle aujourd’hui enseignée en Israël s’est construite en plusieurs étapes. « Pour forger un collectif homogène, il était nécessaire de formuler une histoire multiséculaire cohérente destinée à inculquer à toute la communauté la notion d’une continuité temporelle et spatiale entre les ancêtres et les pères des ancêtres. Parce qu’un tel lien culturel étroit, censé battre au cœur de la nation, n’existe dans aucune société, les « agents de la mémoire » ont dû s’employer durement à l’inventer. Toutes sortes de découvertes ont été révélées par l’intermédiaire d’archéologues, d’historiens et d’anthropologues. Le passé a subi une vaste opération de chirurgie esthétique. »
En deux mots, Shlomo Sand, démonte toute la construction contemporaine qui prétend que les Juifs Séfarades d’Afrique du Nord et les Ashkénazes venus d’Europe de l’Est seraient les descendants d’un peuple exilé ayant habité la Palestine il y a deux mille ans. D’exil forcé et massif il n’en est, en premier lieu, pas de trace sérieuse dans l’Histoire. Ce n’était pas le genre des Romains, somme toute assez tolérants en matière de religion. Mais cet exil forcé, n’en est pas moins le mythe fondateur de l’errance millénaire des Juifs. A ses yeux c’est une vue de l’esprit, au mieux une lecture poétique de l’Histoire. Il explique par ailleurs, que les communautés juives disséminées en Europe, en Afrique ou en Asie mineure, ont longtemps pratiqué la conversion, aujourd’hui regardée avec suspicion, voire rejetée comme non conforme à la notion de « peuple élu » des orthodoxes du moment, que les alliances de voisinage étaient régulières, bref que les critères ethniques n’ont pas de sens, après deux mille ans de joyeux mélange. L’historien décortique à cet effet les multiples aspects de la question, observe les maigres traces laissées dans l’Histoire (notamment l’énigmatique royaume Khazar en Europe centrale au moyen-âge), les filiations linguistiques (le Yiddish, dérivé du haut-allemand) pour enfin évoquer les dernières recherches en matière de génétique, qui infirment la thèse d’une supposée homogénéité ethnique, précisant même que les descendants les plus proches des populations qui peuplaient la Judée il y a deux mille ans sont vraisemblablement… les Palestiniens, convertis à l’Islam au fil du temps. Ce qui, si l’on voulait être rigoureux avec le vocabulaire, ferait aujourd’hui des antisémites non des anti-Israëliens, mais des anti-Palestiniens.
Si continuité il y a, elle est donc exclusivement religieuse. Ce qui est déjà une belle performance, au vu des persécutions dont ont été victimes les adeptes du judaïsme au cours du dernier millénaire. Et il n’est pas question ici de minimiser l’importance de ces persécutions. Pourquoi dès lors, prétendre fonder une « ethnocratie » comme qualifie Shlomo Sand le régime Israëlien (Etat où, je l’ai appris au passage, le mariage civil n’existe pas : seul le mariage religieux est reconnu). Sans doute pour conforter la légitimité d’un Etat, sa propriété historique de « la terre d’Israël », Etat qui redoute apparemment d’en manquer. Il fallait donc s’appuyer sur un mythe fondateur, dont la Bible est la bible, afin de valider, en interne comme en externe, la notion de peuple, de nation et par conséquent de territoire.
*terme abondamment utilisé par l’auteur.
NB : je ne méconnais pas le risque, en rédigeant cette note, d’indisposer quelques lecteurs. Il y a peut-être quelques maladresses de vocabulaire, mais aucune intention maligne. Avant tout procès d’intention, merci de prendre connaissance de l’ouvrage.
Comment le peuple juif fut inventé ?, Shlomo Sand, traduit de l’hébreu par Sivan Cohen-Wiesenfield, édition de poche Champs Flammarion.