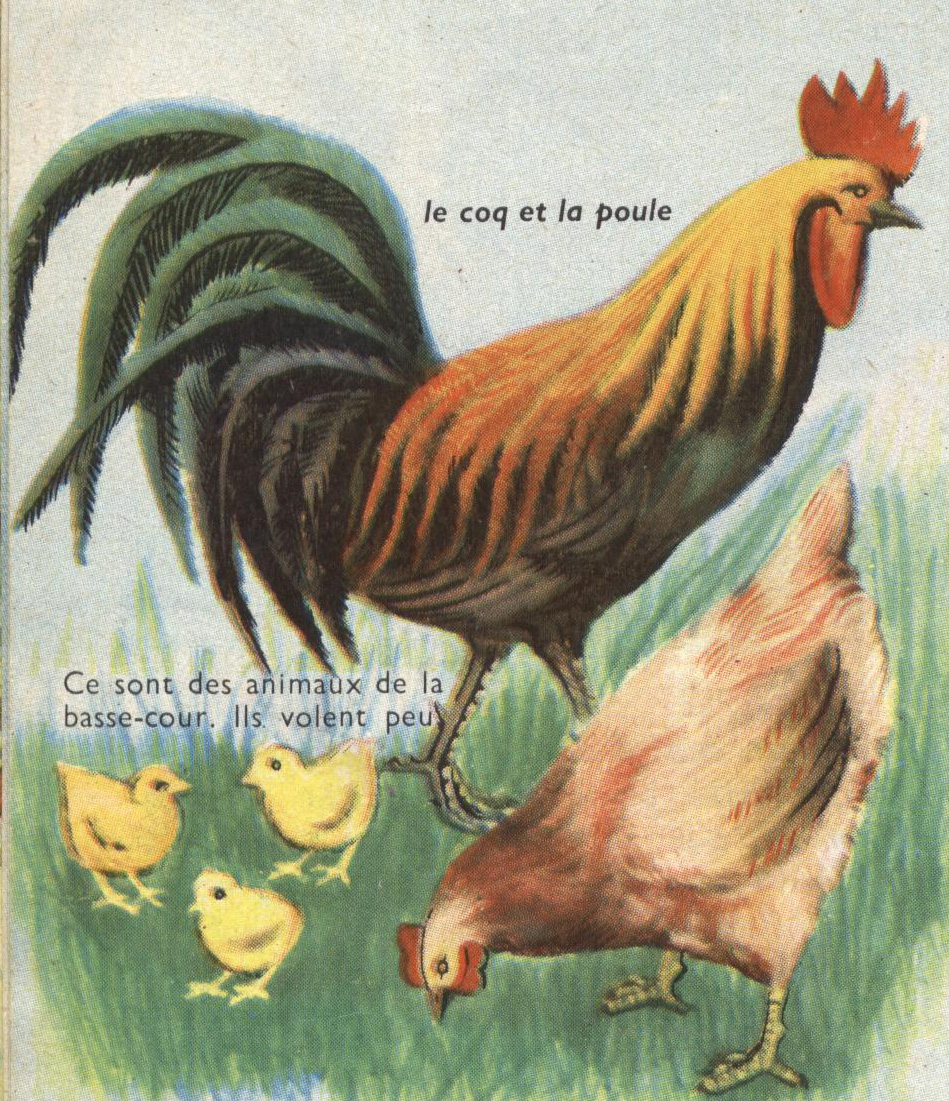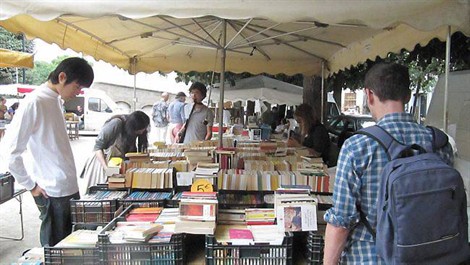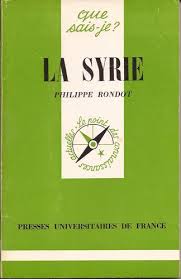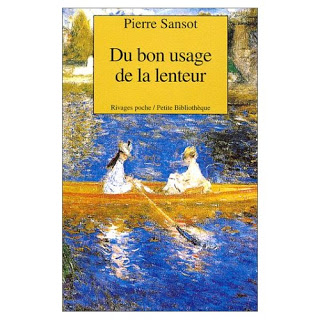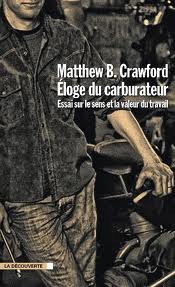Avec le temps, la géographie de la diffusion d’un livre prend des formes inattendues. On sait, grâce à quelques lecteurs, à une commande chez l’éditeur, que tel titre est parti au Canada ou tel autre en Argentine, mais cela reste, disons, anecdotique. On n’imagine pas, même si on peut le souhaiter secrètement, qu’un livre édité à Nantes ou à Rennes soit appelé à voyager au-delà des frontières.
Je viens de découvrir, à la faveur d’une recherche sur mon premier attentat contre la littérature – un livre désormais épuisé – qu’un exemplaire se trouvait, dans sa version anglaise, à la bibliothèque d’Alexandrie, en Egypte. Oui, à la Bibliotheca Alexandrina « The library of Alexandria. ». Incredible.
Mais ce n’est pas tout. Le site en question, relève que plusieurs de mes forfaits, pourtant non traduits, se trouvent dans des bibliothèques en Suisse, en Allemagne et surtout aux Etats-Unis. Et pas des bibliothèques de quartier puis que « L’homme blanc » est disponible à Yale University library, « Derrière la montagne » à la New-York public library et « Balade autour d’Annonay » à Harvard (Harvard college library). Oups.
Restons calme, l’explication de ce mystère réside peut-être dans le fait que ces bibliothèques se procurent systématiquement tous les titres qui paraissent dans le monde (comme le fait la Bnf pour la France par le biais du dépôt légal), même si cela paraît insensé. Mais dans ce cas tous les titres devraient être représentés, et non répartis ici ou là, de façon apparemment aléatoire.
Autre hypothèse, la nature des livres : des récits de voyage ou des monographies traitant d’un lieu. Chaque titre est en effet accompagné de mots clés, à l’image de “L’homme blanc” : Eastern Africa, social life and customs, travel narrative. Ce ne serait pas totalement illogique dans des bibliothèques universitaires, sachant que les anglo-saxons sont, on le sait, plus portés que nous ne le sommes sur les récits de voyage. Mais je n’en sais rien. Il est plus compréhensible, pour des raisons sans doute liées à la seconde guerre mondiale, que « Saint-Nazaire, porte ouverte sur le monde » soit présent dans plusieurs bibliothèques en Allemagne. En revanche que « Tour around Annonay » se retrouve à la bibliothèque d’Alexandrie est un mystère quasi-borgesien.
Ce clin d’œil du ciel ravit l’auteur, vous l’imaginez, et va lui donner du cœur à l’ouvrage pour poursuivre la composition, pour l’heure interrompue, du récit de voyage entamée cet été, et qui se déroule, justement, aux Etats-Unis, où un lecteur francophile débusquera peut-être, dans de longues années, un petit bouquin poussiéreux lui proposant un regard singulier sur son pays au début des années quatre-vingt. Il n’est pas interdit de rêver.
Illustration : improbables librairies