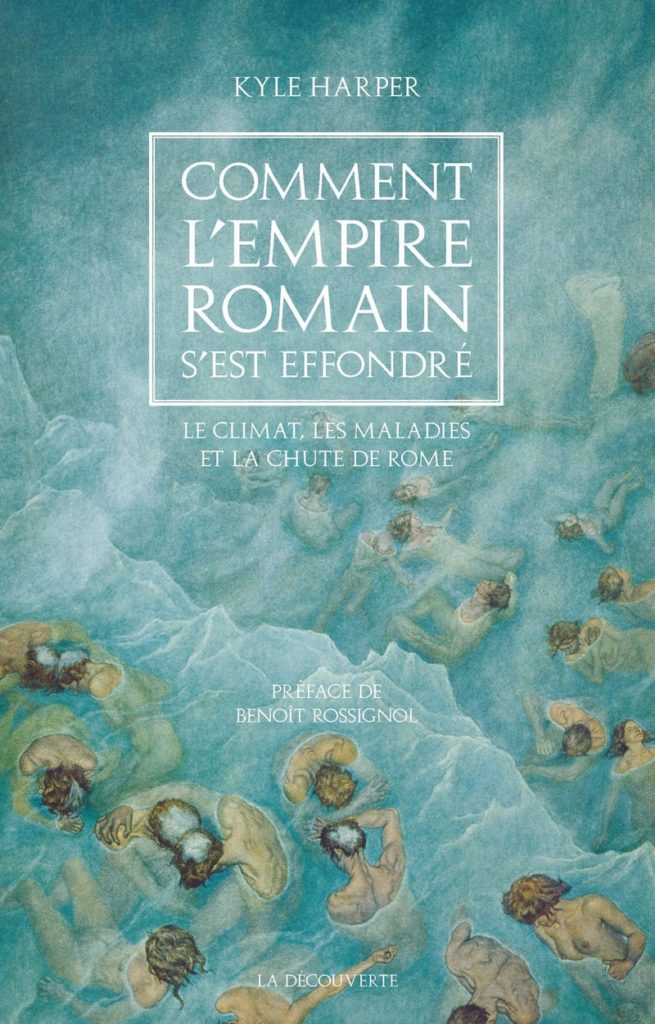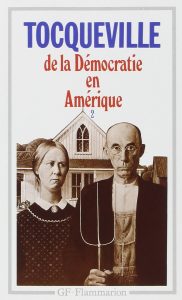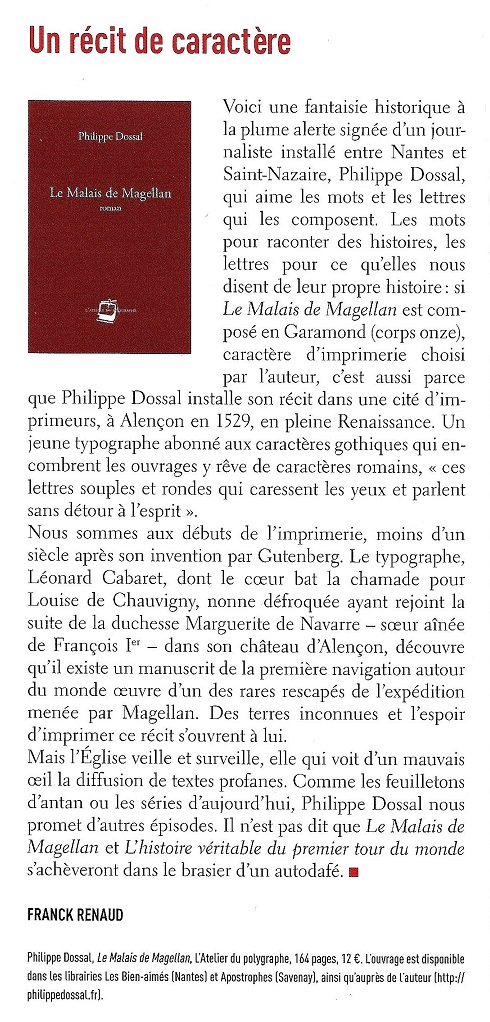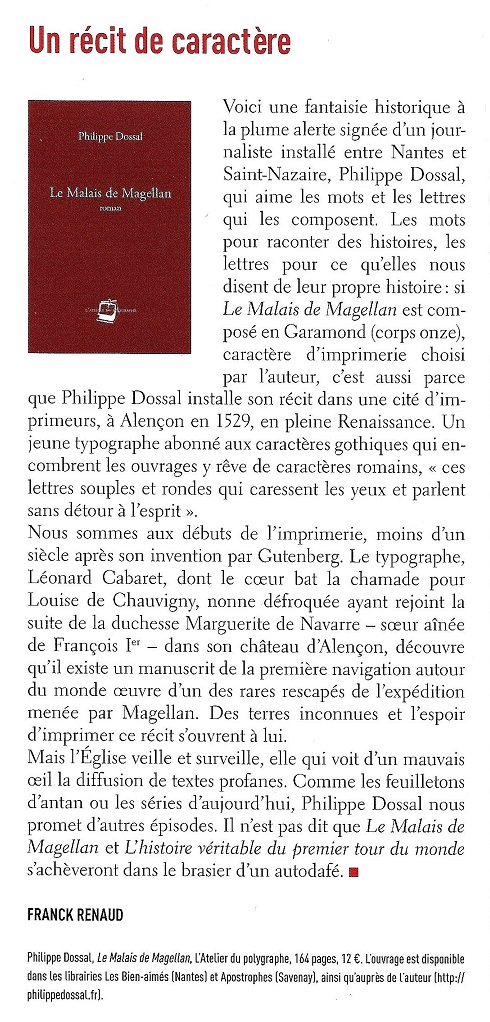“Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre” écrivait Goethe (enfin c’est ce que prétendent mes carnets). La formule pourrait figurer en quatrième de couverture de l’ouvrage que nous occupe ici Comment l’Empire Romain s’est effondré tant cet essai de l’Américain Kyle Harper provoque le vertige. Précisons qu’il a été écrit en 2017 et publié en France début 2019, quelques mois avant l’apparition de la Covid19 (nous dirons la Covid pour faire plaisir à l’Académie). Il ne s’agit donc pas d’un essai opportuniste mais d’un réel travail scientifique, indépendant du contexte pandémique que nous connaissons.
Précision liminaire, je suis en cours de lecture, et le déchiffrage de ce pavé, 540 pages avec les notes, va me prendre un peu de temps. Je suis un lecteur lent, c’est ainsi. Et je sais que le temps est le prix à payer pour éclairer sérieusement la pensée. Mais je ne suis pas inquiet, la préface et les premiers chapitres de l’ouvrage montrent toute la rigueur scientifique de ce travail, écrit à la lumière des récentes découvertes sur l’histoire du climat et le développement des pandémies au cours de l’Antiquité tardive.
Donc, donc ces précisons apportées, venons en au fait. Contrairement à une idée reçue, Rome se portait bien en 400, dix ans avant son sac par les Wisigoths. La ville comptait 700 000 habitants et jouissait de tous les avantages d’une ville classique à l’échelle impériale, même si les empereurs n’y vivaient plus. Selon un état des lieux datant du IVe siècle On y dénombrait 423 quartiers, 44 602 habitations, 290 greniers, 856 bains, 28 bibliothèques et… 46 bordels. Bref, une ville prospère, comme put le constater l’Empereur et son consul au tout début de l’an 400, salués par une série de fastueuses cérémonies. “Grâce au discours du poète Claudien, nous savons que l’on a offert au peuple toute une ménagerie exotique qui reflétait bien les prétentions globales de l’Empire.” relève Kyle Harper.
On est loin donc de la perception classique du lent déclin de l’Empire Romain, popularisée par le grand historien Gibbon au XIXe siècle et de son Histoire de la décadence et la chute de l’Empire Romain (ouvrage néanmoins passionnant, que j’ai lu en son temps sur la recommandation de Borgès). Kyle Harper revisite entièrement le mythe à la découverte de récentes avancées scientifiques, qui révèlent la fin d’un l’optimum climatique atteint au IVe siècle, lequel, plus humide, avait été une bénédiction pour toute la région méditerranéenne et avait présidé au développement de la ville et de l’Empire.
“Les changements climatiques ont favorisé l’évolution des germes, comme Yersina Pestis, le bacile de la peste bubonique” commente l’éditeur. “Mais les Romains ont aussi été les complices de la mise en place d’une écologie des maladies qui ont assuré sa perte. Les bains publics étaient des bouillons de culture, les égoûts stagnaient sous les villes, les greniers à blé étaient une bénédiction pour les rats, les routes commerciales qui reliaient tout l’Empire ont permis la propagation des épidémies de la mer Caspienne au mur d’Hadrien avec une efficacité jusque la inconnue. Le temps des pandémies était arrivé.”
Cette lecture des évènements est étayée par une multitude de recherches contemporaines, rendues possibles grâce, notamment, à une précision nouvelle du carottage des glaces et au développement de la dendrochronologie (méthode scientifique permettant la datation des pièces de bois à l’année près en analysant les anneaux de croissance). Comme tout essai argumenté qui se respecte, l’ouvrage de Kyle Harper est truffé de références, n’hésite pas à fouiller la profondeur historique, relatant notamment l’épisode de la peste antonine, qui fit 500 000 morts au IIe siècle et dont le célèbre Galien fut témoin.
Qui plus est, le bouquin est fort bien écrit, très vivant et semble bien construit. C’est donc une recommandation sans réserve aucune, même s’il faut un peu de courage pour s’y atteler. Pour ma part j’alterne, comme à l’accoutumée, avec d’autres lectures et j’envisage de l’emporter avec moi dans les îles où j’ai prévu de passer l’hiver, (au grand dam j’imagine de Catherine B. qui me l’a recommandé et prêté, qu’elle en soit ici remerciée) et qui risque de ne pas le revoir avant le printemps . Histoire de revenir un peu plus averti, et peut-être, de poser un regard un peu moins effaré sur l’étrange période qui s’ouvre à nous.