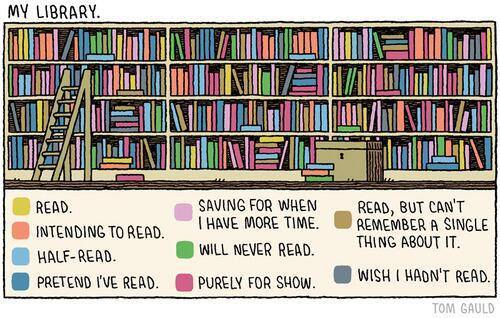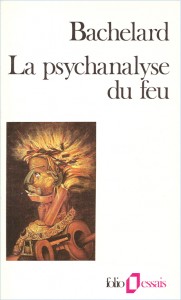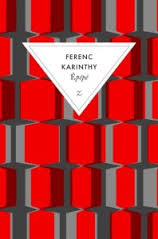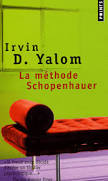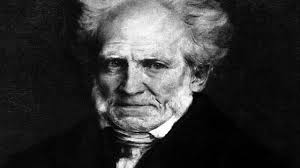L’islam et ses pratiques, pas plus que tout autre phénomène humain, n’échappent aux mutations au fil de l’histoire. La question de la représentation figurée en général, et de celle du prophète de l’islam en particulier, a été diversement tranchée selon les périodes et les milieux. Si elle a parfois déclenché des débats animés, elle ne semble pas avoir posé un problème majeur ou permanent aux croyants musulmans ni à leurs juristes (Naef 2004). Les polémiques récentes, parmi les plus vives qu’aient connues l’histoire, sont attisées par le fait que les images qui les ont déclenchées sont des caricatures ; elles alimentent l’idée fausse et essentialiste que, « de tout temps », l’islam aurait interdit la représentation de son prophète, voire toute représentation humaine. Encore faudrait-il savoir de quel objet on parle lorsqu’on utilise le terme « islam », dont les significations multiples sont trop souvent confondues ou tenues pour équivalentes : parle-t-on de l’islam sunnite, de l’islam chiite ? Des pratiques des croyants, qu’il faut toujours rapporter à un contexte géographique et historique précis ? Des textes sacrés de l’islam, en premier lieu du Coran, ou des interprétations des juristes et des exégètes ? De l’islam des fatwas (lesquelles, émises par quelle autorité religieuse, et dans quel contexte ?) ou d’un ressenti qui peut, lui aussi, varier d’un croyant à l’autre ? Plus que jamais, les désastreux soubresauts d’une actualité vite montée en épingle doivent être considérés à l’aune de l’histoire et les phénomènes récents, comme la sensibilité de nombre de croyants musulmans à la question de la représentation de leur prophète, doivent être replacés dans une perspective historique longue pour échapper à une vision univoque et figée de l’islam et de ses adeptes.

Contrairement à une idée reçue fort répandue dans les milieux musulmans et non musulmans, le Coran n’interdit en aucune manière la représentation figurée, celle des hommes pas plus que celle des animaux. La réprobation coranique est en revanche très forte envers les pratiques idolâtres qui auraient caractérisé le polythéisme de l’Arabie préislamique. Il s’agit de la condamnation, ferme et précise, de l’utilisation dans le cadre du culte d’images de divinités, peintures, statues ou statuettes. Un épisode célèbre de la biographie de Muhammad, telle qu’elle fut ordonnée et mise par écrit à partir de récits oraux à partir du viiie siècle de l’ère chrétienne, met en scène le prophète de l’islam détruisant les centaines d’idoles contenues dans le sanctuaire de la Kaaba lorsqu’il entra victorieusement à La Mecque en l’an 8 de l’hégire (630 de l’ère chrétienne)[illustration 2]. Cet épisode n’exprime pas une interdiction absolue de l’image mais met en scène le triomphe de l’islam, monothéisme pur, sur le polythéisme mecquois symbolisé par les idoles. De fait, dans l’empire islamique en formation, l’usage des représentations figurées (humaines et animales) fut rapidement banni des lieux de culte musulmans, sans que soient pour autant interdits les décors floraux ou figuratifs qui ornent par exemple les mosaïques de la mosquée des Omeyyades de Damas, construite au début du viiie siècle.

Plus que dans le Coran, une méfiance plus générale envers les images s’exprime dans certains textes de la tradition musulmane, notamment dans le corpus des hadiths, qui relatent sous forme de petits récits des actes et des dires attribués à Muhammad. La fonction première des hadiths était d’apporter une réponse normative aux nombreuses questions non résolues par le texte coranique : les faits et gestes du prophète, ses déclarations et même parfois ses silences, tels qu’ils furent rapportés d’abord oralement par ses Compagnons puis par les générations suivantes, sont interprétés comme des modèles de comportement. L’ensemble des hadiths tenus pour authentiques par les savants des premiers siècles de l’islam constitue la Sunna. Dans ce corpus, la question de l’image n’est pas centrale, bien qu’une certaine méfiance s’y fasse jour envers ceux qui fabriquent des images, suspects de vouloir se comparer au Créateur. Certains hadiths sont cependant ouvertement hostiles aux images, affirmant qu’une maison qui en abrite ne sera jamais visitée par les anges. Les textes juridiques musulmans anciens débattent aussi parfois la question de la licéité des images ; bien que les avis n’aient pas tous été concordants en la matière, à partir du viiie siècle, le droit musulman naissant se montre dans l’ensemble réticent envers la production et l’usage d’images d’hommes et d’animaux.
Cette réticence des juristes, touchant principalement le domaine du culte, ne conduisit pas, dans un premier temps, à bannir toute représentation imagée dans le domaine profane. Au temps des califes omeyyades de Damas (661-750), les murs des palais, résidences aristocratiques et bains s’ornaient volontiers de scènes de chasse, de figures humaines et animales, comme en témoignent les riches fresques murales du palais jordanien de Qusayr ‘Amra (début du viiie siècle) : celles du hammam comportent, entre autres, des images de baigneuses dénudées. Au cours du Moyen Âge, animaux et personnages ornaient fréquemment certains objets du quotidien, textiles et céramiques. Une riche tradition de manuscrits enluminés vit le jour en Mésopotamie au xiie siècle ; des œuvres littéraires narratives y étaient illustrées de miniatures mettant en scène des personnages humains parfaitement représentés. L’illustration d’ouvrages scientifiques était elle aussi fréquente, incluant des représentations de personnages humains et d’animaux de toutes sortes. Les productions artistiques du domaine islamique sont donc loin de se réduire à l’arabesque géométrique ou aux décorations florales.
Parmi les figures humaines représentées par des artistes du monde musulman, celle de Muhammad ne semble pas, dans un premier temps, avoir constitué une exception notable. Les miniatures le représentant à visage découvert se multiplièrent à partir du xiiie siècle, sans que ces représentations ne suscitent de débats enflammés parmi leurs contemporains. Il est vrai que ces ouvrages comptaient sans doute un nombre restreint de lecteurs, issus majoritairement des milieux aristocratiques susceptibles de commanditer ou d’acquérir de tels produits de luxe.


Les derniers siècles du Moyen Âge virent ainsi fleurir des miniatures représentant Muhammad. Ces portraits s’inspiraient des descriptions textuelles contenues dans les biographies du prophète ou dans un type particulier d’ouvrages, les shamâ’il, consacrés à la description physique de Muhammad telle que rapportée par le hadith. Les images des xiiie-xvie siècles sont proches de ces descriptions textuelles : Muhammad y figure le plus souvent sous la forme d’un homme d’âge mur, doté d’une barbe soigneusement taillée et coiffé d’un turban. Son teint est rose, ses traits bien dessinés, son visage est parfois encadré par deux mèches de cheveux. Il apparaît toujours nimbé de flammes, ou bien la tête entourée d’un halo [illustration 4] ; il y partage cette particularité avec les anges et les autres prophètes, et parfois même d’autres membres de sa famille, eux aussi représentés à visage découvert. Moins fréquemment, Muhammad est parfois représenté sous la forme d’un jeune homme imberbe, pour illustrer les épisodes anciens de sa vie, précédant la révélation. Les miniatures le mettent en scène dans les moments marquants de son histoire. L’épisode plus célèbre est celui de son ascension céleste, le mi‘râj, sur le dos d’une monture ailée dotée d’une tête de femme, le Burâq. Au fil des siècles, cette ascension prit une importance croissante dans les récits biographiques et les traités mystiques et donna lieu à d’innombrables représentations [illustration 5].

À partir du xvie siècle, les portraits figurés du prophète de l’islam devinrent plus rares, et une iconographie particulière se développa, qui consistait à voiler le visage de Muhammad ou à le symboliser par une flamme, ou parfois par son nom calligraphié. Les historiens de l’art ont même mis en évidence certains cas où des peintures anciennes, qui figuraient visiblement ses traits, ont par la suite été grattées, effacées ou, plus discrètement, recouvertes d’un voile masquant son visage [comme peut-être dans l’illustration 6]. De plus en plus, l’ensemble de la personne du prophète était symbolisé par un grand nimbe de flammes dorées[illustrations 3 et 7]. Bien que son visage ou même l’ensemble de son corps ne soient pas toujours représentés, on continua cependant, en contexte safavide comme ottoman, à illustrer de scènes très vivantes les biographies de Muhammad et d’autres ouvrages historiographiques ou mystiques.

Il est difficile d’évaluer si cette pratique consistant à effacer les traits du prophète découle véritablement de la désapprobation des ulémas envers sa représentation figurée ; de fait, la réitération de l’interdiction en la matière est récente. L’historienne de l’art Christiane Gruber interprète plutôt ce phénomène comme l’extension, dans le domaine de l’art, d’une tendance à l’abstraction reflétant la diffusion de thèmes mystiques associant Muhammad à la « Lumière prophétique », émanation de la Lumière divine, principe créateur universel et symbole de la divinité unique échappant à toute représentation (Gruber 2009). Ces idées se développèrent dans le contexte de l’Iran safavide et sont largement représentées dans la poésie persane de l’époque. Elles insistent sur le fait que l’essence du prophète ne peut être appréhendée que par une vision de l’âme, et s’accompagnent de descriptions allégoriques de la « lumière prophétique », symbolisée par le nimbe de flammes.
À l’époque contemporaine, la multiplication des images dans le monde musulman s’est accompagnée de phénomènes variés. Si, dans l’Iran chiite d’aujourd’hui, il n’est pas rare que des portraits imaginaires de Muhammad ou de l’imam Husayn décorent les rues en temps de festivités religieuses, en particulier pendant la commémoration du deuil de ‘âshûrâ’, le monde sunnite se montre globalement hostile à la représentation figurée de son prophète – sans même parler du cas volontairement polémique que constituent les caricatures. Reste cependant à rappeler qu’il fut un temps où artistes comme public musulmans considéraient la production et la contemplation de portraits de leur prophète comme une expression de leur dévotion, et non comme une pratique blasphématoire réservée aux seuls détracteurs de l’islam.

Pour en savoir plus
Bibliographie
- Nef Annliese , Van Renterghem Vanessa, 2011, Muhammad, Paris, la Documentation française (Les récits primordiaux).
- Naef Sylvia, 2004, Y a-t-il une question de l’image en islam ?, Paris, Téraèdre (L’Islam en débats).
- Gruber Christiane, 2009, « Between Logos (Kalima) and Light (Nur): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting », Muqarnas 26, p. 229-262. [version pdf en ligne]: http://umich.academia.edu/ChristianeGruber/Papers/443477/_Between_Logos_Kalima_and_Light_Nur_Representations_of_the_Prophet_Muhammad_in_Islamic_Painting
Quelques ressources sur Internet
- Mandragore, le site de la BnF dédié aux manuscrits enluminés, permet l’accès à quelques dizaines d’enluminures de manuscrits arabes, turcs ou persans contenant des représentations de Muhammad (choisir le mot-clé « Muhammad » dans la rubrique « Descripteur »). Quelques-unes le présentent à visage découvert (Ms Arabe 1489, Persans 54 et 376, Suppléments turcs 190 et 1063), d’autres avec le visage voilé (Supplément turc 1088) ou symbolisé par un grand nimbe doré (Supplément persan 1030). http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp,
- Une page anglaise de Wikipedia rassemble une cinquantaine d’enluminures produites en contexte musulman et représentant le prophète sous différents aspects ; certaines légendes laissent toutefois à désirer. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Muslim_depictions_of_Muhammad
Pour citer ce billet : Vanessa Van renterghem, « La représentation figurée du prophète Muhammad »,
Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient(Hypothèses.org), 29 octobre 2012.
[En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/4445
*plutôt que de proposer un lien, j’ai opté pour une reproduction de ce texte de Vanessa Van Renterghem publié sur sur le site de l’institut français du Proche Orient, de façon à en favoriser la diffusion auprès de certain public cultivé mais non érudit, à un moment où le besoin d’outils de compréhension semble plus que jamais nécessaire.