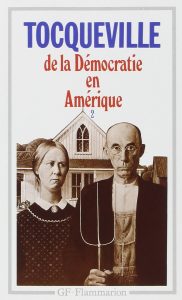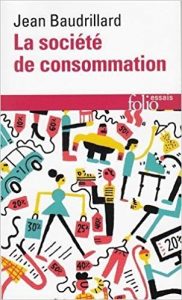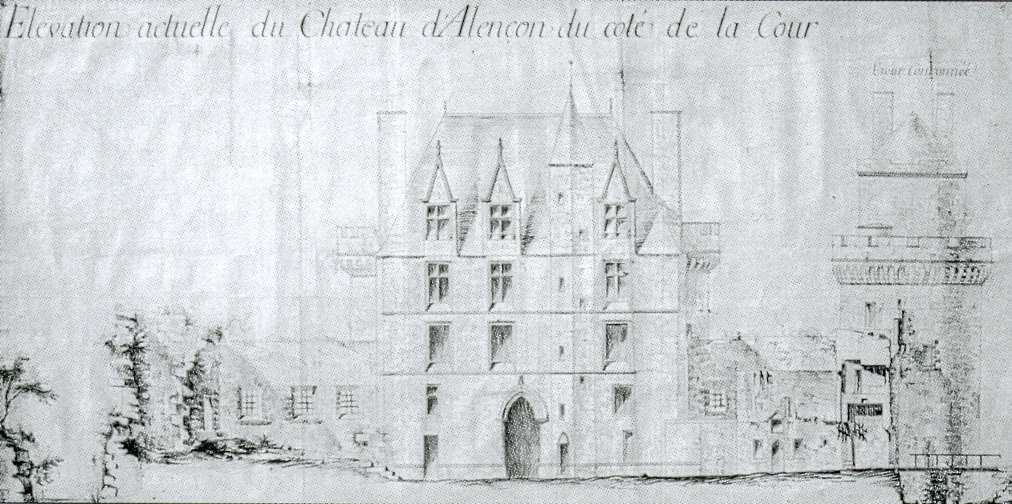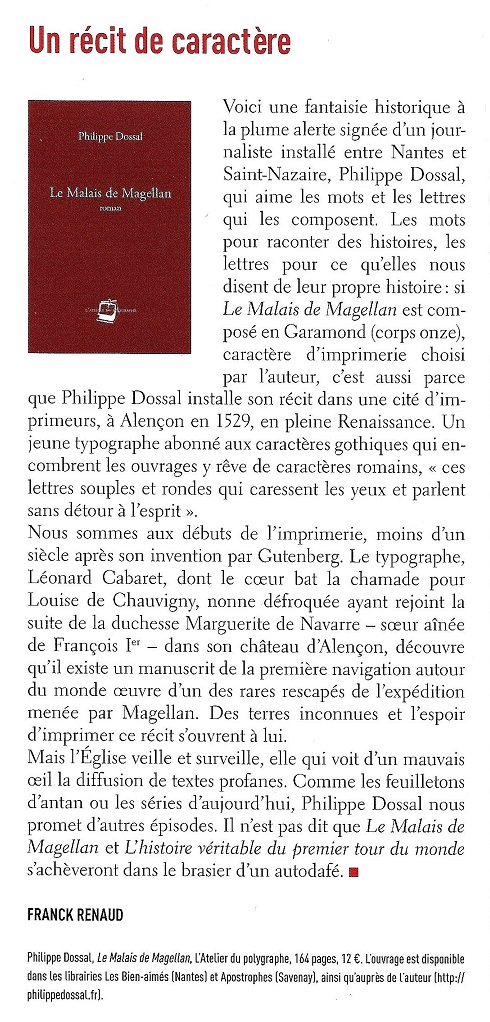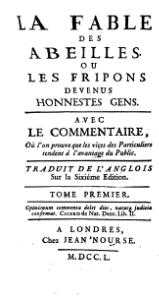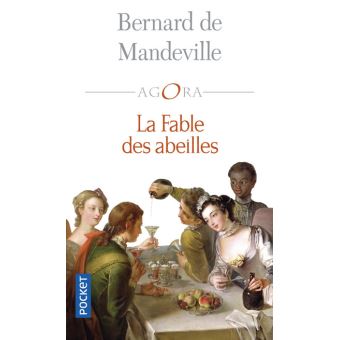“Elle était belle comme la femme d’un autre”. Cette pensée fugace de Paul Morand parle bien souvent aux hommes. Mais qu’en est-il des femmes ? Quels éclairs, quels tourments traversent l’esprit et le coeur d’une femme de trente ans, dont le corps s’évade à la recherche de sensations inédites ? Déployer de Douna Loup déplie en sept livrets les états d’âme et de corps de l’une d’entre elles, Elly, mère de deux filles, qui vit en couple à la campagne. Une exploration singulière, une descente vertigineuse à l’intérieur d’une femme.

Pour mettre en lumière ce tourment intérieur, Douna Loup a choisi une forme extrêmement libre, une sorte de vagabondage de l’esprit, qui lui permet d’emmener son lecteur dans des profondeurs qu’elle ne connait pas elle-même. “Ce qu’il faut savoir pour lire la suite de l’histoire c’est que je ne connais rien à la suite de l’histoire. et c’est cela le plus important. Etre certain de ne rien savoir par avance, ni de soi, ni des autres….” Cette liberté de forme autorise une confession déliée de toute convenance, dont l’objectif est clairement affiché : mettre des mots sur des sensations qui échappent à la jeune femme, la débordent, l’enchaînent à ses propres contradictions.
Le désir, l’ambiguité des relations entre les hommes et les femmes, la maternité, la jalousie qui tord le ventre, tout y passe dans un livret ou dans un autre de ce livre protéiforme. L’ordre de lecture des sept livrets n’a pas d’importance. On y retrouve la même histoire, les mêmes personnages, à un moment différent de l’aventure ou sous une perspective nouvelle. C’est assez déstabilisant au départ, mais cela fonctionne parfaitement. On dispose au bout du compte d’un éclairage panoramique des états d’âme d’Elly, de pans entiers de son histoire aussi, de clefs qu’elle va chercher dans les tréfonds de son enfance.
“… la consolation attendue de l’extérieur ne viendra pas… elle doit pousser à l’intérieur de soi… Il vient un jour où je m’aperçois que je ne sais pas vivre…” ces extraits tronqués notés à la volée peinent à donner le ton de cette confession étonnante, profonde sans être crue, et pour tout dire pénétrante, sans mauvais jeu de mots. Une rare occasion pour un homme de visiter l’intérieur d’une femme. Une occasion aussi de mesurer qu’au bout du compte femmes et hommes ne sont pas si différents, et que la monogamie reste, pour les unes comme pour les autres, une construction culturelle, toujours difficile à domestiquer.
Déployer, Douna Loup, Editions Zoé Genève. 7 livrets, 5040 possibilités de lecture