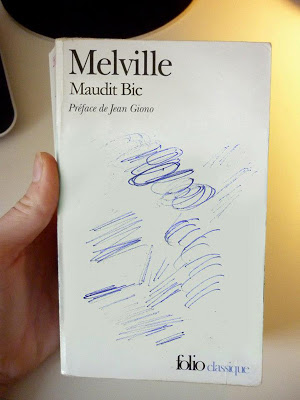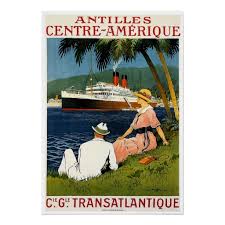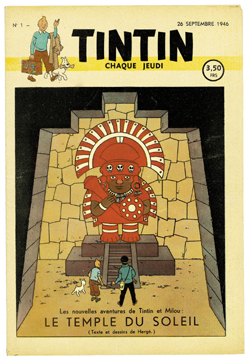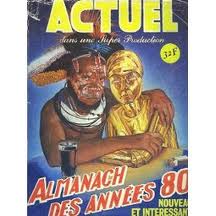« Le traité conclu à Tordesillas le 7 juin 1494 entre le Portugal et l’Espagne, après le refus, par le premier, de l’arbitrage par le pape Alexandre VI, instaure un nouvel ordre mondial dominé par la puissance maritime ibérique. Les terres à découvrir qui s’étendent à l’ouest d’un méridien tracé à 370 lieues à l’ouest de îles du Cap-Vert appartiendront à l’Espagne; celles qui sont situées à lest de cette ligne, notamment les côtes africaines ainsi que les Indes orientales, appartiendront au Portugal. Face à l’Islam, les deux royaumes ibériques incarnent la chrétienté triomphante. »
C’est ainsi que débute la préface au « Voyage de Magellan » de Chandeigne, un bijou d’édition, dont je rêvais depuis sa présentation par Michel Chandeigne en personne lors d’une récente édition d’Etonnants Voyageurs à Saint-Malo. De ces livres qui cumulent toutes les qualités : complet, beau, merveilleusement illustré et doté d’un excellent appareil critique. L’ouvrage s’appuie, bien sûr, en premier lieu sur la relation d’Antonio Pigafetta, marin et chroniqueur italien, l’un des rescapés de cette aventure d’anthologie. Magellan, mort aux Mariannes, lui doit la notoriété posthume et abusive qui fait de lui le premier navigateur à avoir réalisé la première circum-navigation. 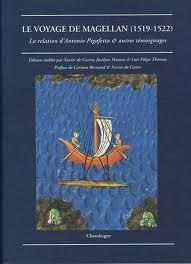
La première surprise de ce récit est le malentendu de départ. L’expédition de Magellan, navigateur portugais passé au service de l’Espagne, n’a pas pour but de faire le tour du monde, mais de prendre possession des Moluques, îles réputées pour leurs épices, au nom de l’Espagne. L’idée de Magellan, qui n’est pas sans savoir que la terre est ronde (on le sait depuis les Grecs, l’Eglise le reconnaît, mais on pense le globe plus petit) est d’ouvrir une nouvelle route, par l’ouest, en franchissant l’Amérique, considérée à l’époque comme une simple bande de terre séparant l’Atlantique de l’océan Indien. Il compte revenir par la même route pour ne pas empiéter sur le domaine Portugais, qui s’étend, selon le traité de Tortedillas, du Brésil aux confins de l’Asie. Espagnols et Portugais ne s’étaient pas contentés de se séparer l’Amérique en 1494, ils s’étaient carrément attribué chacun une moitié de planète (carte ci-dessous, partie portugaise au centre).
Le texte de Pigafetta est assez lapidaire sur la première partie du voyage. Il est habilement complété dans l’édition Chandeigne, par des renvois sur les récits des autres survivants, qui développent certains épisodes, notamment les règlements de comptes, trahisons et naufrages qui ponctuent la première partie du voyage. L’un des bateaux prendra ainsi la décision de quitter la flotte, en plein milieu du détroit de Magellan – qui ne l’est pas encore – pour rejoindre l’Espagne. Ce récit, dont la copie originale a disparu, et dont il reste quatre versions, l’une en Vénitien (qui semble la plus fiable) et trois en français, est aussi abondamment complété par un ensemble de notes donnent l’état des dernières recherches sur le sujet.
Pigafetta est un fidèle de Magellan, lui pardonne ses cruautés mais relève toutefois la folie de l’entreprise de son capitaine lorsque ce dernier se lance avec soixante hommes à l’assaut d’un roitelet alors que son adversaire dispose de plusieurs milliers de guerriers. Les dernières recherches tendent à montrer que l’expédition avait un côté suicidaire et que ce geste apparemment insensé pourrait s’expliquer par le désarroi de Magellan, comprenant que, malgré ses calculs, il était parvenu dans le domaine Portugais et que toute cette aventure se soldait par un échec. Le voyage n’en continue pas moins, et la flotte, réduite à trois puis deux navires (sur les cinq du départ) poursuit sa découverte des iles du pacifique (ainsi nommé au terme de cette première traversée), tâchant de convertir au christianisme les souverains locaux au passage, à l’aide de miroirs et de couteaux. Pour un lecteur contemporain, le récit est pollué par le maquis d’appellations d’époque qui désignent des îles que l’on a du mal à situer sur une carte. Mais peu importe.
Ce qui fait le charme indéniable de cette aventure c’est la qualité du regard de Pigafetta, qui découvre chaque jour, une plante un animal, un mode de vie inconnus. Telle cette description d’un phasme : « Encore on trouve là des arbres qui ont telles feuilles que, quand elles tombent, elles sont vives et cheminent. et sont ces feuilles ni plus ni moins comme celles d’un mûrier mais non pas tant longues. Près de la queue d’un côté et de l’autre, qui est courte et pointue, elles ont deux pieds, n’ont point de sang et devant qui les touche elles s’enfuient. » Joli, non ?
Mais au delà de ce récit, c’est une page centrale de l’histoire de l’humanité qui se précise sous nos yeux. Songeons que c’est précisément au même moment que Cortès conquiert Mexico avec quatre cents hommes. L’Eglise est toute puissante, a distribué le monde, ivre de sa domination. L’ère de la diffusion des connaissances, de la Réforme et des pirates peut s’ouvrir.
Illustrations : Improbables bibliothèques (A.K.), Le voyage de Magellan, le partage du monde (D.R.)