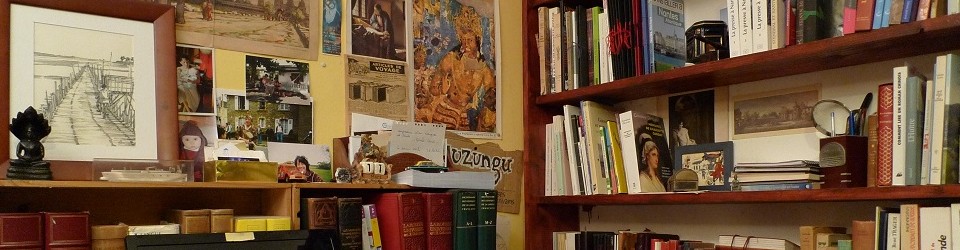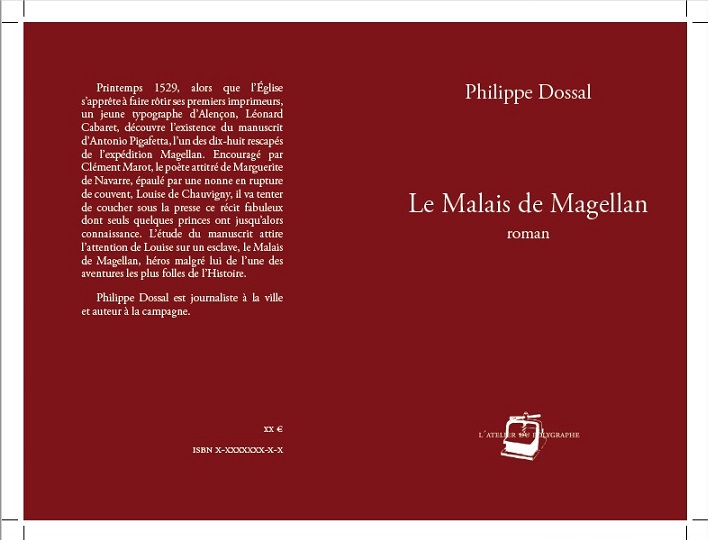7 – Le Hâvre de grâce
Les garçons localisent Lecourt mais perdent la trace des gravures de Villon. Départ pour le Hâvre de Grâce. Un charpentier de marine évoque l’expédition de Magellano. Léonard décide de retrouver le manuscrit de Pigafetta.
Guillaume avait raison, les jeunes gens ne tardent pas à recueillir des nouvelles de Lecourt. Enfin, à le localiser, faute d’informations sur sa condition et son état. C’est en effet au rez-de-chaussée du palais épiscopal que se situent les prisons de l’archevêché, palais qui jouxte la cathédrale. Et c’est là que le curé de Condé est vraisemblablement enfermé, en attendant une première instruction. Un bâtiment somptueux, élevé voilà quelques années par le cardinal d’Amboise, le précédent archevêque de Rouen. « Dis-donc, il avait les moyens ton cardinal » commente Guillaume en observant la façade de ce palais aux belles et grandes fenêtres à meneaux s’étageant sur trois niveaux, lui donnant des allures de château urbain. « Il avait surtout des relations puisqu’il était le principal conseiller du bon roi Louis XII. De mémoire c’est lui qui avait obtenu du pape l’annulation du premier mariage de Louis, l’autorisant à épouser Anne, la duchesse de Bretagne. Un mariage d’amour figure-toi, Louis adorait Anne, ce n’est pas si courant chez les têtes couronnées. Le roi a été éternellement reconnaissant à l’archevêque de Rouen, qui ne s’est pas fait prier pour embellir son archevêché à sa guise. »
Ebahi par l’ornementation des vitraux, Léonard n’en est pas moins songeur « et après l’Eglise s’étonne que certains fidèles se scandalisent de l’étalement de telles richesses. S’il y a une indignation que je partage avec Lecourt, c’est bien le commerce des indulgences. D’une certaine façon on peut dire que les vitraux de ce palais sont payés par les années de purgatoire que les bourgeois croient s’éviter en versant leur écot au clergé. Je ne suis pas certain que le Christ aurait marché dans ce coup là. Enfin le Christ des Evangiles traduites par maitre Lefebvre. Ce n’est peut-être pas le même après tout. »
« Ah, les garçons, vous voilà. J’ai quelques informations pour vous ». Maitre Pierre les interpelle à leur retour à l’atelier. « J’ai fait un tour rapide de mes amis libraires et, comme je m’en doutais, il est quasi certain que les bois du Villon n’ont pas été gravés à Rouen et qu’ils ne s’y trouvent vraisemblablement pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il me semble que ça va t’intéresser Guillaume. » Asseyez -vous deux minutes leur lance-t-il leur montrant le banc qui fait face à sa table de travail, encombrée d’épreuves. Nous avons à Rouen l’une des plus belles écoles d’enluminures du royaume, encouragée et financée par le cardinal d’Amboise, qui adorait les riches ouvrages illustrés. Il en a d’ailleurs offert plusieurs à la famille royale et la bibliothèque du palais archiépiscopal en regorge. Lorsque la gravure s’est développée, dans la foulée de l’imprimerie, les enlumineurs rouennais n’ont pas voulu céder la place. Ils ont donc gardé la main sur le tracé des illustrations et la mise en couleur, la rehausse de certains exemplaires, reléguant les graveurs à l’unique besogne de la taille du bois, de la taille en épargne comme on dit. De simples exécutants en quelque sorte. Cette technique a produit des gravures excessivement fleuries, au décor plein, emplissant chaque pouce d’un cadre bordé d’arabesques. A la manière des anciens manuscrits. »
« Les authentiques graveurs sur bois, plutôt issus du monde de la sculpture, ont pour leur part créé un univers plus sobre. Leur mission n’était, il est vrai, pas tout à fait la même. Il s’agissait dans la plupart des cas d’illustrer des textes en langue vulgaire. Des manuels pratiques, d’organisation ménagère ou de médecine, comme vous avez dû en imprimer chez Simon du Bois. » Guillaume, fort intéressé, acquiesce. Le graveur se retrouve dans ce portrait, lui qui pensait être un cas isolé, un profil singulier dans son petit monde alençonnais. Maître Pierre poursuit « Ils ont ainsi imaginé des images expressives et immédiatement lisibles. Il s’agit bien souvent de la seule figuration d’un personnage, campé de face ou légèrement de profil, ou de scènes de la vie quotidienne comme c’est le cas pour la première édition du Villon. C’est ce qui me fait dire que ces bois ont été gravés à Paris et non à Rouen. Si ça se trouve l’ensemble du livre a même été imprimé à Paris. Vous savez comme moi que les cartouches indiquant la provenance des ouvrages ne veulent pas dire grand-chose, tant les autorités sont versatiles et les inquisiteurs prompts à sévir, contraignant les imprimeurs à la plus grande prudence. »
La piste des gravures semble bel et bien s’arrêter ici. Les deux garçons n’en sont pas trop désappointés. Guillaume, ragaillardi et légitimé dans son art et sa pratique se dit qu’il pourra peut-être proposer ses services à Clément pour cette nouvelle édition – après tout, les bois originaux du Villon ne sont pas d’une facture irréprochable, sont même un peu gauches s’il en croit les estampes de l’exemplaire que leur a confié le poète – et Léonard voit se profiler une respiration salutaire dans l’attente de nouvelles concrètes de Lecourt. « Et si on en profitait pour filer à Dieppe voir ces sauvages que nous avons ratés à notre arrivée » propose-t-il à Guillaume. « Aubert doit remonter la Seine. Il ne peut naviguer qu’en profitant du courant à flot, quand la mer se retire de l’estuaire » l’interrompt Olivier Pierre. « Il ne sera pas facile à localiser avant quelques jours. Si vous vous intéressez aux sauvages, il vaut mieux essayer de l’intercepter au Havre de Grâce, cela vous permettrait de découvrir le port nouveau que vient de fonder le roi François, pour justement armer les navires qui partent vers le nouveau monde. »
Il n’en faut pas plus pour convaincre les deux garçons, qui enfourchent leur monture dès le petit matin et filent vers les rives de la mer océane, enveloppés par les vapeurs cotonneuses du fleuve. La nuit est déjà tombée lorsqu’ils s’attablent à l’auberge du Roi François au pied des remparts du Havre de Grâce. Il règne une belle confusion dans cet estaminet qui occupe le rez-de chaussée, où les serveuses ont le verbe haut et le téton généreux, à l’image de la jolie brunette qui leur découvre un paysage vertigineux en se penchant pour déposer leurs doubles chopines. « Les choses ne commencent pas trop mal » sourit Guillaume qui observe, la paupière mi-close, les tenues et les gestes de la population bigarrée et braillarde qui peuple le lieu. On est loin, de fait, de la retenue et de l’élégance bourgeoise qui prévaut dans les rues de Rouen. Mais cette atmosphère de marins débraillés et de commerçants vantards n’est pas pour déplaire aux jeunes gens. Ils ne devraient pas éprouver trop de difficultés à obtenir les informations qu’ils recherchent au prix d’une ou deux chopines. Avec la complicité de leur jolie brunette, Marie-Anne, ils convient ainsi à leur table un grand gaillard corpulent et crasseux, manifestement familier des lieux, qui commande illico un verre de rhum.
« Aubert, Aubert. Il me semble qu’il est passé aujourd’hui et reparti avec la marée » leur répond ce Jean Mabire, charpentier de marine de son état, dont les mains calleuses mais musclées et agiles, trahissent le travail quotidien du bois. Mabire, qui a l’alcool bavard, leur confie louer ses services à la journée pour assurer les réparations urgentes sur les navires de retour de campagne avant leur descente de l’estuaire. Natif de Rouen il est venu tenter la fortune au Hâvre de Grâce il y a une dizaine d’années sans grand succès. Il confesse une fâcheuse tendance à dépenser ses maigres gains, le soir venu dans les tavernes du port. « Des sauvages venus de la Terre-Neuve, c’est vrai qu’on n’en voit pas souvent » ajoute-t-il en découvrant une bouche édentée, « même si les morutiers de Dieppe ont maintenant pris le pli d’aller pêcher de l’autre côté de la mer océane. Mais ce ne sont pas ceux-là, moi, que j’aimerais rencontrer, mais bien plutôt ceux des îles Malucques. Ceux qui cultivent les épices et sont couverts d’or, ainsi que les a vus, de ses yeux vus, Richard Le Normand, le charpentier d’Evreux, le seul Français revenu, dit-on, de l’incroyable expédition d’un capitaine Portugais, un certain Magellano, il y a une demi-douzaine d’années.»
Léonard marque un temps d’arrêt. S’agirait-il de l’aventure dont lui a parlé Clément l’autre jour, de la navigation autour du monde dont la reine mère possède le récit ? Reprenant ses esprits, l’imprimeur bombarde le charpentier de questions, prenant le soin de commander une autre rasade de rhum à Marie-Anne, que Guillaume couve d’un œil de plus en plus chaleureux. « Vous connaissez ce Normand ? Vous l’avez rencontré ? C’est lui-même qui vous a parlé de ces sauvages ? De ce capitaine Magellano ? » « Oh, je l’ai vu une fois, sur le chantier, avant son dernier embarquement pour les Indes orientales, il y a trois ou quatre ans. Il venait chercher quelques pièces de chêne maigre pour bricoler sur le pont. C’est là qu’il m’a parlé de cette aventure. Il voulait à tout prix retourner aux Malucques, mais pas par la route prise quelques années plus tôt, qui avait fait souffrir le martyre aux équipages. La route de l’Orient est beaucoup plus simple et beaucoup plus courte que celle des Indes occidentales disait-il, en évoquant ce pays de cocagne, ce chapelet d’îles qui regorge d’épices, où les gens vont nus, portant une simple pièce de toile autour de la nature. Richard avait amassé un beau ballot d’épices, qu’il conservait précieusement enroulé dans son hamac, mais capturé par les Portugais aux îles du Cap-Vert sur le chemin du retour, il avait tout perdu avant de remettre le pied dans le port de Séville. Il entendait bien se refaire cette fois et s’acheter, à son retour, l’atelier dont il rêvait. Malheureusement, si l’on en croit la rumeur, la caraque sur laquelle il s’est embarqué a sombré corps et biens au large du cap de Bonne-Espérance. On l’a appris un an plus tard. Il avait eu de la chance une fois, il n’en a pas eu deux.»
Ce récit plonge Léonard dans une mer de perplexité. « C’est incroyable, songe-t-il. Cette aventure, si elle est avérée, se promène en fragments, en lambeaux, disséminée ici dans le cabinet d’une princesse, là dans la taverne d’un port. Elle doit forcément courir les quais, sauter d’île en île, de comptoir en entrepôt. Se déformer aussi, ou être déformée à l’envi par des princes qui conservent jalousement les découvertes de navigateurs qui restent leurs obligés. Il faudrait rassembler tout ça, à tout le moins imprimer le récit de ce Pigafetta, le rendre public, donner à tous, et non plus aux seuls puissants, la possibilité de comprendre comment est fait ce monde. Il y a peut-être une possibilité. Si je me souviens bien, Clément m’a dit qu’il avait eu accès au manuscrit du découvrement de l’Inde supérieure offert à la reine-mère. Il faut absolument que je trouve un moyen de le consulter moi aussi, et de le copier. »