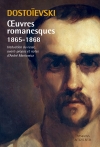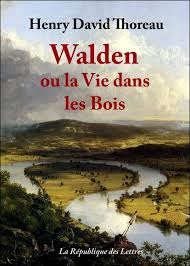C’est une sorte de bible païenne dont la particularité est d’être basée sur des faits réels, s’appuyant sur des personnages, Crésus, Cyrus ou Thalès de Milet, qui ont existé dans la vraie vie. Histoires d’Hérodote est tout simplement le premier livre d’Histoire. C’est d’ailleurs de ce livre que nous vient le mot, lequel signifie, à l’origine, enquête. Histoires est le fruit de l’enquête de toute une vie, celle d’un Grec du Ve siècle avant JC (habitant d’Halicarnasse sur la côte sud de l’actuelle Turquie) qui eut la géniale idée d’aller vérifier sur le terrain toutes les histoires qui se racontaient à cette époque dans ce qui était alors considéré comme le monde civilisé (bassin méditerranéen et Moyen-Orient). Témoignages, documents, monuments, Hérodote a arpenté toute la région, a disséqué, épluché, avec une naïveté qui lui a certes parfois été reprochée, pour nous transmettre un document incroyable, dont la rédaction a pris vingt ans, et qui nous parvenu quasiment en l’état.
C’est une sorte de bible païenne dont la particularité est d’être basée sur des faits réels, s’appuyant sur des personnages, Crésus, Cyrus ou Thalès de Milet, qui ont existé dans la vraie vie. Histoires d’Hérodote est tout simplement le premier livre d’Histoire. C’est d’ailleurs de ce livre que nous vient le mot, lequel signifie, à l’origine, enquête. Histoires est le fruit de l’enquête de toute une vie, celle d’un Grec du Ve siècle avant JC (habitant d’Halicarnasse sur la côte sud de l’actuelle Turquie) qui eut la géniale idée d’aller vérifier sur le terrain toutes les histoires qui se racontaient à cette époque dans ce qui était alors considéré comme le monde civilisé (bassin méditerranéen et Moyen-Orient). Témoignages, documents, monuments, Hérodote a arpenté toute la région, a disséqué, épluché, avec une naïveté qui lui a certes parfois été reprochée, pour nous transmettre un document incroyable, dont la rédaction a pris vingt ans, et qui nous parvenu quasiment en l’état.
J’avais été amusé, il y a quelques années, par la lecture du premier tableau de ces Histoires, découvertes en feuilletant un lot de livres anciens et je m’étais promis d’y revenir. Ce tableau peint la manière dont débute une série de lourds malentendus qui vont enflammer le bassin méditerranéen et provoquer une longue inimitié entre Grecs et Barbares. L’histoire est assez jolie. Elle prétend que les Phéniciens, venus déballer une cargaison de marchandises d’Egypte et d’Assyrie dans le port d’Argos en Grèce, avaient attiré « une troupe nombreuse de femmes », dont Io, la fille du roi, venues en quelque sorte faire les soldes avant le départ des navires. « Les Phéniciens se précipitèrent sur elles et les ayant embarquées sur leur vaisseau, partirent en cinglant vers l’Egypte. » Ce fut là, ajoute Hérodote, « le premier incident qui commença la série des torts. » Il y a de la chair dans ce livre.
Ce n’est certes pas le genre d’ouvrage que l’on avale d’une traite, mais une portion d’héritage comme celle-là peut bien requérir quelques années, qu’importe, et l’ouvrage est opportunément divisé en neuf livres. Seul aspect pénible de la lecture, la litanie des généalogies, qui nuisent à la fluidité du récit pour le lecteur contemporain. Confessons-le, je m’en débarrasse sans états d’âmes en sautant ce type de passage.
Il faut toutefois disposer d’une édition armée d’un bon appareil de notes (et, merci internet, ne pas hésiter à situer les lieux sur une carte) pour ne pas trop souffrir à la lecture de cet étonnant document. Dans l’ensemble la posture d’Hérodote est assez moderne. S’il raconte dans les moindres détails les superstitions de l’époque, notamment le recours aux oracles, il n’en garde pas moins une neutralité absolue à l’égard des dieux, allant même jusqu’à se montrer facétieux. Ainsi lorsque Crésus, le Lydien, demande aux oracles de Delphes s’il doit faire la guerre aux Perses, l’auteur reprend, sans commentaire, la redoutable réponse faite à Crésus, laquelle l’informe que s’il fait cette guerre il détruira un grand empire. Suspense.
 Cette édition idéale m’est tombée dans les bras il y a quelques jours. Il s’agit de l’édition des Belles-Lettres (texte traduit par Ph.E. Legrand, de l’Institut, préface et notes de A.Dain) reprise par la collection Les Portiques du Club français du livre en 1957. Un seul volume grand format, imprimé sur papier bible. Les Portiques se voulaient à l’époque le pendant de La Pléiade, le confort du format en plus. Le luxe quoi pour une vingtaine d’euros. N’oubliez surtout pas, si vous le cherchez, de passer par livre-rare-book, véritable site de bouquinistes et non par Abebooks, filiale d’Amazon (je mets le lien par précaution). En cette période de cadeaux : il reste un levier précieux, celui du ticket de caisse.
Cette édition idéale m’est tombée dans les bras il y a quelques jours. Il s’agit de l’édition des Belles-Lettres (texte traduit par Ph.E. Legrand, de l’Institut, préface et notes de A.Dain) reprise par la collection Les Portiques du Club français du livre en 1957. Un seul volume grand format, imprimé sur papier bible. Les Portiques se voulaient à l’époque le pendant de La Pléiade, le confort du format en plus. Le luxe quoi pour une vingtaine d’euros. N’oubliez surtout pas, si vous le cherchez, de passer par livre-rare-book, véritable site de bouquinistes et non par Abebooks, filiale d’Amazon (je mets le lien par précaution). En cette période de cadeaux : il reste un levier précieux, celui du ticket de caisse.
Illustrations: Hérodote fragment (bibliothèque d’Alexandrie), Les Portiques collection.