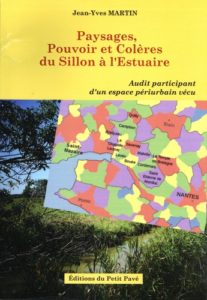Pour fêter l’avancée de La Tentation de Louise, voici un extrait qui se déroule à Nantes. J’ai renoncé à le publier en feuilleton, en raison des remaniements permanents infligés au texte. Mais ce chapitre, le second, ne devrait plus guère bouger. Si tout va bien, j’espère pouvoir publier le livre au printemps. Rappelons que nous sommes en l’an 1534.
2 – Le quai de la Fosse
Assis au pied du rempart de la ville close, Léonard observe les charpentiers pendus à l’aplomb du fleuve, qui fixent les poutrelles de bois destinées à consolider le quai du port au vin. Le typographe aime faire un saut hors les murs lorsqu’il dispose d’une heure ou deux, pendant que les épreuves sèchent sur les fils de l’atelier. Les mauvaises langues de l’imprimerie ne manquent pas de remarquer qu’il se dirige invariablement vers les tavernes interlopes du quartier de la Fosse, où officient les filles à matelots, mais peu lui importe. Il serait d’ailleurs en peine de nier son attrait pour ce quartier hors la loi commune, où les marins sont rois et les gardiens des bonnes mœurs malvenus. S’il goûte de temps à autre une visite à la plantureuse Annaïck, qui tient un peu plus loin sur le quai une auberge à l’enseigne du Trois-Mâts, il passe le plus clair de son temps à observer le travail des ouvriers qui préparent de nouveaux appontements. Il faut en effet gagner sur la grève à l’ouest de la ville close pour accueillir les navires hauturiers qui se pressent de plus en plus nombreux à l’entrée du port. Léonard Cabaret, typographe alençonnais, aura mis deux bonnes années à se mouvoir à son aise dans cette cité portuaire, où il a dû se réfugier au lendemain d’une chasse aux imprimeurs dans sa ville natale. Il s’y sent bien aujourd’hui, dégagé des comptes à rendre à la rumeur publique et aux curés un peu trop inflammables. Et puis il a singulièrement progressé dans son art, maîtrisant la composition des cahiers, l’impression en deux couleurs et la reproduction des gravures.
Un peu plus loin vers le soleil couchant on aperçoit les navires qui, faute de place, sont amarrés à couple au droit des entrepôts en bois plantés sur le rivage, d’où les soutiers déchargent le sel de la côte, les toiles du Léon et la laine d’Espagne. La ligne de ponts qui franchit la Loire à deux pas du Bouffay empêche ces grands voiliers, dont on dit que certains jaugent plus de deux cents tonneaux, de remonter plus haut sur le fleuve. Ce qui provoque un ballet incessant de chariots qui transbordent les marchandises vers le port fluvial, à l’amont du château, et reviennent chargés de vins de Loire en partance pour la haute mer. La joyeuse confusion provoquée par la variété des langues parlées sur les quais ravit Léonard, qui ne se doutait pas, depuis sa Normandie, qu’autant de façons de s’exprimer pouvaient cohabiter en un même lieu. Ouvriers et matelots échangent volontiers en bas-breton, un idiome rocailleux imperméable à ses oreilles, dont il aime pourtant la musique. On y parle aussi anglais et hollandais, enfin c’est ce qu’il suppose en débusquant ici ou là une expression familière. Les échanges sur les quais procèdent d’un mystérieux sabir portuaire, mélange de toutes ces langues, que les marins semblent comprendre intuitivement. Léonard a plus de facilité avec l’espagnol, sans doute grâce à sa maitrise du latin, dont les accents résonnent souvent sur la Fosse où quelques armateurs de Bilbao ont installé leurs agents. Les Espagnols sont gourmands de toiles de chanvre confectionnées en Bretagne pour équiper les navires qu’ils ne cessent d’armer à destination des Indes Occidentales, de l’autre côté de la mer Océane. Léonard ne le cache pas lors de ses passages au Trois-Mâts, il est fasciné par les marins ibériques, qui élargissent le monde en courant les océans à bord de leurs caraques. Il aimerait bien en savoir plus, lui qui a rêvé des heures en imprimant le récit d’Antonio Pigaffeta à la découverte des îles Molluques, mais les matelots espagnols ne sont pas très bavards. Ils risquent trop gros, tant les couronnes d’Espagne et du Portugal sont jalouses de leurs découvertes et, plus que tout, des portulans qu’établissent leurs capitaines voyage après voyage. Il est d’ailleurs interdit, sous peine de mort, à tout marin étranger d’embarquer pour les Indes Occidentales, propriété exclusive de la couronne impériale.
De retour par la place du Change, sur le chemin du Bouffay où est installé son atelier, enfin l’atelier de maître Hervouët, il songe à la chance des Nantais de se trouver ainsi placés à la porte d’entrée du royaume. Les boutiques débordent de draps, de cuirs, de vins et même d’épices que les marins espagnols font passer en contrebande. Maitre Hervouët est un imprimeur-libraire honnête, moyennement intelligent mais redoutablement efficace, au visage affaissé de vieux chien sympathique qui inspire une confiance naturelle. Léonard s’est acclimaté avec le temps à ce patron placide et laborieux qui s’est spécialisé dans les livres d’heures à destination des bourgeois de la cité. Un choix judicieux du fait de la prospérité des armateurs, des commerçants et des hommes de loi qui occupent gaillardement la place depuis le démantèlement de la cour de Bretagne. Les aristocrates bretons sont, pour la plupart, retournés sur leurs terres, depuis le départ de feu la reine Anne, arrachée à son dûché par les rois de France, laissant un château en chantier. En arrivant dans cette cité inconnue, Léonard a erré quelque temps avant de trouver une place de compagnon dans l’atelier de maître Hervouët. Et s’il n’a pas noué de lien véritable avec l’imprimeur, trop calotin à ses yeux, il ne lui en est pas moins reconnaissant de lui avoir permis de progresser dans l’art de composer des livres illustrés. A vrai dire, il se languit un peu de sa terre natale, de sa famille, de son ami Guillaume, le graveur, qui a trouvé refuge à Paris. Ne parlons pas de Louise, la chambrière de la duchesse, avec qui il a renoncé à correspondre, à laquelle il voue des sentiments ambigus qu’il ne sait pas décrypter lui-même. Est-il possible de trouver la bonne distance avec une femme aussi attachante qui ne vous est pas destinée ? Il en doute, trop souvent embarrassé durant leur brève relation par des pensées coupables, et préfère laisser les braises s’éteindre doucement.
Par bonheur, il y a d’autres jupes à trousser dans la bonne ville de Nantes. Et en premier lieu l’éruptive Annaïck, qui lui a fait miroiter une surprise ce soir, à la fermeture du Trois-Mâts. Mais avant cela, et puisque le travail de la presse ne pourra reprendre aujourd’hui, faute de papier, Léonard décide de pousser jusqu’à la cour du château pour jeter un œil sur l’avancement du pavillon que le roi François fait construire au dos de la muraille qui donne sur le fleuve. Décidément ce roi ne traîne pas, la Bretagne à peine réunie à la couronne, le souverain s’est attaqué sans tarder à l’agrandissement du château des ducs pour y ajouter un bâtiment de plaisance où il entend séjourner lors de ses passages à Nantes. Le grand Logis est trop froid à ses yeux et il souhaite disposer d’un pavillon plus moderne et surtout plus facile à chauffer. Léonard prend plaisir à observer les maçons assembler les blocs de tuffeau qui composent la façade, presque achevée. Le pavillon est de proportions plus modestes que le grand logis et d’une bienvenue sobriété. L’heure semble passée des ornements gothiques. Le typographe est surtout frappé par la taille des fenêtres à meneaux, parfaitement alignées au premier étage et par la mince corniche qui souligne d’un trait discret l’harmonie de l’ensemble à mi-hauteur du rez-de-chaussée. Il est vraisemblable que le roi a fait appel à un architecte italien pour dessiner ce pavillon, qui semble ouvrir de grands yeux étonnés face à l’immense façade quasi aveugle du grand logis.
Annaïck qui a passé, selon les poètes, l’âge où une femme de belle devient bonne, est la maîtresse la plus surprenante que Léonard ait jamais connu. Il n’en revient pas. C’est une découverte, le plaisir volcanique que peut prendre une femme entre les draps. Un feu savamment caché sous des allures de matrone respectable, qui prend soin de masquer soigneusement ses atouts pour rester maîtresse de ses élans. Les marins trop entreprenants en savent quelque chose, qui sont régulièrement invités à se réserver leur énergie aux soubrettes de la taverne. Ce n’est pas Léonard qui a choisi Annaïck, c’est elle qui a séduit tranquillement ce jeune imprimeur égaré, détonant avec la clientèle habituelle de la maison. Un caprice de veuve ? Il n’est pas parvenu à savoir si elle se joue de sa compagnie, ou si elle lui voue un attachement sincère. Quoi qu’il en soit, les jeux de mains ne sont pas à l’ordre du jour ce soir au Trois-Mâts, dont les volets sont maintenant clos. Annaïck est à la fois grave, concentrée et un brin narquoise en finissant de ranger les tables. Manifestement contente du coup qu’elle prépare. Elle va le combler d’une manière inattendue son petit imprimeur. Le rangement achevé, son visage se détend, elle se débarrasse de son tablier, s’assoit et agite deux livrets, juste cousus, devant les yeux du typographe. « Un marin espagnol vient de me confier ces deux lettres, qu’il ne peut conserver par devers lui. Ce sont les lettres des Indes Occidentales, envoyées par un capitaine, du nom d’Hernàn Cortès, à l’Empereur Charles Quint. Elles ont été imprimées à Séville, traduites en latin, et ont circulé pendant quelques mois dans les chancelleries de l’Empire, mais Charles Quint vient de demander qu’elles soient brûlées, toutes, qu’il n’en reste pas de trace. Il ne souhaite pas, m’a dit mon subrécargue espagnol, que l’on en sache trop sur ses expéditions par-delà la mer océane. Il est embarrassé et me demande de mettre les exemplaires qu’il possède à l’abri pendant quelque temps ».
Léonard est sonné. Annaïck, qui semblait ne prêter qu’une oreille distraite à ses confidences nocturnes, à ses envolées passionnées sur l’élargissement du monde, l’écoutait en fait avec attention. Et semble mesurer la portée des documents qu’elle tient entre les mains, à tout le moins l’intérêt qu’ils ont pour lui, même si elle ne connaît pas un traitre mot de latin. « Si tu le souhaites, dès que le navire de mon Espagnol aura appareillé, je te confierai ces documents pour que tu puisses en prendre connaissance. Ils doivent bien contenir quelques-unes de ces histoires de sauvages qui t’enchantent. » Léonard se précipite à son cou avec une fougue de jeune chien. « Tout doux l’ami, tout doux. Tu vas rentrer paisiblement dans ton gourbi du Bouffay et nous en reparlerons plus tard. Pour l’heure je suis rincée par cette longue journée, et je ne rêve que de m’endormir paisiblement en goûtant au plaisir véniel d’en avoir remontré à un marin d’eau douce de ton espèce ».
Cet extrait n’est pas destiné à circuler. Le copyright est assuré par la date de parution sur cette publication en ligne ISSN 2497-7144.