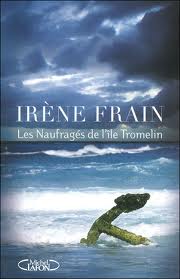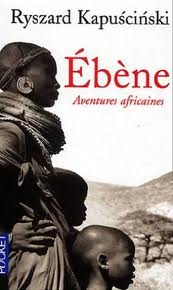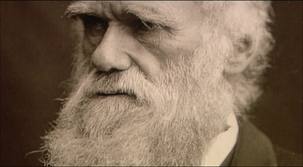“Pourquoi cette habitude de placer sur les étagères où s’accumulent, où s’empilent les livres, des photographies, cartes postales, des reproductions de tableaux ? C’est pour moi plus qu’une habitude, une nécessité, comme si je voulais qu’avant d’avoir accès aux pages imprimées des images soient là, comme si seule leur présence allait donner vie à ce qui autrement risquait de n’être qu’un discours, mots, lettres, peut-être même lettres mortes.
 Ainsi, alors que les livres sont classés selon un strict ordre alphabétique, se créent des voisinages intempestifs. Voisinages voulus parfois : la photographie de Sartre fumant sa gitane papier maïs est placée à côté de celle de Flaubert avec sa bouffarde et ses bacchantes de Gaulois; celle de Sylvie Germain devant la Bible qui inspire ses personnages. Plus souvent les voisinages sont arbitraires ou étranges : Merleau-Ponty en short et en chemise grande ouverte, est à côté d’un Goethe plutôt compassé, prenant la pose du grand penseur; une photographie du jeune Valéry, col dur et yeux clairs, au visage illuminé, se trouve tout près du Cheval dévoré par un lion de Géricault; un dessin de Matisse qui, en quelques traits de crayon, nous donne à voir la grâce d’une femme pensive est accolé au portrait de quatre philosophes austères qui jettent un regard réprobateur sur une femme nue, alanguie, de Modigliani.
Ainsi, alors que les livres sont classés selon un strict ordre alphabétique, se créent des voisinages intempestifs. Voisinages voulus parfois : la photographie de Sartre fumant sa gitane papier maïs est placée à côté de celle de Flaubert avec sa bouffarde et ses bacchantes de Gaulois; celle de Sylvie Germain devant la Bible qui inspire ses personnages. Plus souvent les voisinages sont arbitraires ou étranges : Merleau-Ponty en short et en chemise grande ouverte, est à côté d’un Goethe plutôt compassé, prenant la pose du grand penseur; une photographie du jeune Valéry, col dur et yeux clairs, au visage illuminé, se trouve tout près du Cheval dévoré par un lion de Géricault; un dessin de Matisse qui, en quelques traits de crayon, nous donne à voir la grâce d’une femme pensive est accolé au portrait de quatre philosophes austères qui jettent un regard réprobateur sur une femme nue, alanguie, de Modigliani.
 Quand je cherche un livre dans ma bibliothèque, je m’attarde d’abord un instant sur l’image qui le cache; non elle ne le dissimule pas, elle permet au contraire d’aller vers lui. Cette collection de photographies, de reproductions de tableaux ou dessins, constitue pour une part mon “musée imaginaire”. Mais je ne veux pas qu’il demeure immobile. Je le renouvelle de temps à autre, je puise dans mes “réserves”, j’en sors des cartes postales; achetées au cours d’un voyage ou que m’ont adressées des amis.
Quand je cherche un livre dans ma bibliothèque, je m’attarde d’abord un instant sur l’image qui le cache; non elle ne le dissimule pas, elle permet au contraire d’aller vers lui. Cette collection de photographies, de reproductions de tableaux ou dessins, constitue pour une part mon “musée imaginaire”. Mais je ne veux pas qu’il demeure immobile. Je le renouvelle de temps à autre, je puise dans mes “réserves”, j’en sors des cartes postales; achetées au cours d’un voyage ou que m’ont adressées des amis.
 Alors mon paysage change et les livres s’animent, se réveillent. Dans une autre pièce, plus intime, sont fixées sur un mur les photographies de ceux que j’aime le plus au monde. personne ne peut les voir que moi. Elles représentent bien plus qu’un paysage. elles sont ma vie, la source fraîce de ma vie.”
Alors mon paysage change et les livres s’animent, se réveillent. Dans une autre pièce, plus intime, sont fixées sur un mur les photographies de ceux que j’aime le plus au monde. personne ne peut les voir que moi. Elles représentent bien plus qu’un paysage. elles sont ma vie, la source fraîce de ma vie.”
J.B. Pontalis “Le Dormeur éveillé”.
Pour ma part les images ne sont pas devant les livres, elles les entourent, les accompagnent, leur répondent. Mais sans la présence de ces images, la bibliothèque me semblerait privée de vie. Sans La tour de Babel de Brueghel ou une facétie de Gil jourdan, Borgès ne serait pas tout à fait le même, Montaigne ne serait qu’un vieux crabe. Aujourd’hui fenêtre ouverte sur le printemps, festival de chant d’oiseaux. Du coup, reprise de Darwin, en écho à cette joyeuse lutte pour l’existence.
illustrations : pipe découpée je sais plus où, Le géographe de Vermeer, Albert Camus et sa clope.