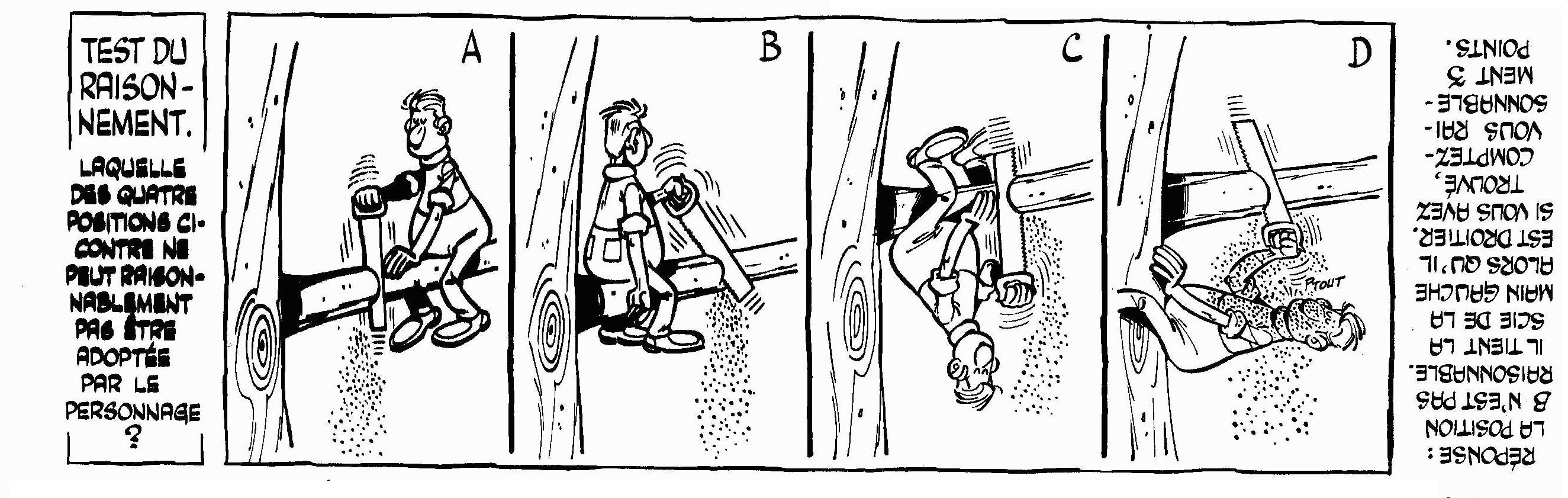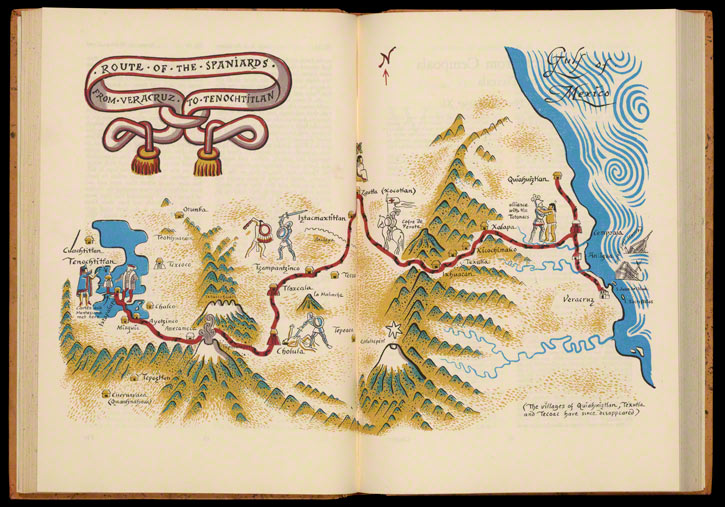La fiction est, on le sait, beaucoup moins inventive que la réalité. Et il ne fait guère de doute que le mystère du Boeing disparu servira de trame, le moment venu, à quelque roman à succès ou à quelque production hollywoodienne.
 Mais si la réalité offre souvent une généreuse matière première à la fiction, la littérature et le cinéma ont une force que n’aura jamais l’enquête la plus fouillée, le procès le plus rigoureux : celle d’entrer dans la peau de personnages plongés dans des situations invraisemblables, et de proposer une lecture de leurs comportements lorsqu’ils sont confrontés à des conditions extrêmes.
Mais si la réalité offre souvent une généreuse matière première à la fiction, la littérature et le cinéma ont une force que n’aura jamais l’enquête la plus fouillée, le procès le plus rigoureux : celle d’entrer dans la peau de personnages plongés dans des situations invraisemblables, et de proposer une lecture de leurs comportements lorsqu’ils sont confrontés à des conditions extrêmes.
C’est le cas de Lord Jim de Joseph Conrad, roman inspiré d’un fait divers d’une envergure comparable à celui du Boeing disparu : l’abandon par son équipage, en plein océan, d’un vapeur rempli de huit cents pèlerins chinois à l’approche d’un ouragan. Lord Jim, commandant en second du navire, se retrouve sans l’avoir vraiment voulu dans la chaloupe des officiers qui abandonnent les passagers à une mort certaine. Mi-victime, mi-complice, il n’en assume pas moins au cours de son procès, la responsabilité de ses actes, alors que ses pleutres acolytes se défilent ou sombrent dans la folie.
Jim va ensuite tenter d’expier cet acte impardonnable en subissant l’exil sur les côtes malaises, à l’abri du monde, au service entier d’une population oubliée. Mais la rémission d’un pêché originel de cette nature est-elle possible ? La mort n’est-elle pas préférable ? Tout l’art de Conrad tient dans la lecture de cette bataille intérieure qui se livre chez Lord Jim. Mais cette lecture n’est pas psychologisante, n’est pas empathique, elle est froide, plutôt proposée de l’extérieur, dans la tradition anglo-saxone.
C’est un roman complexe, un savant tissage, dont les motifs n’apparaissent que très progressivement, au fil d’un récit, il faut en convenir, assez tortueux. Cela n’en reste pas moins un chef d’œuvre de la littérature, qui résonne étrangement avec l’actualité, à l’heure où l’on fouille l’histoire des pilotes et des passagers d’un avion disparu pour tenter de comprendre l’incompréhensible.