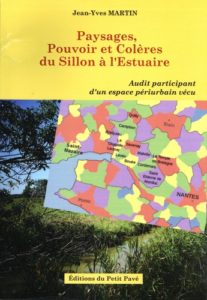Quand la femme, cet être supérieur apte à résoudre 99% des problèmes de vie quotidienne, vient à manquer, l’homme est bien souvent appelé à mettre en oeuvre des stratégies de contournement qui aboutissent parfois à d’utiles trouvailles, qu’il peut être tentant de partager. Frère célibataire ou solitaire, j’ai donc décidé de faire un pas de côté épisodique sur ce blog, pour une série irrégulomadaire que nous intitulerons le manuel du castor senior.
La démocratie participative

Il est parfois des arbitrages délicats, lorsque l’on hésite entre deux solutions et que l’on ne peut plus consulter sa moitié. Le recours à la consultation des jeunes gens peut-être une alternative. Imaginons par exemple que vous soyez amené à planter un olivier dans une région où le climat n’est pas nécessairement idéal pour lui, surtout en hiver. Vous disposez d’une magnifique jarre, qui permettrait de le déplacer et de le mettre à l’abri le moment venu. Mais cette jarre, sans fonction précise, sinon de servir d’élevage de moustiques l’été, a longtemps été un terrain de jeu prisé des enfants et fait partie de leur imaginaire. Si l’on subodore que sa neutralisation définitive pourrait heurter les sensibilités, une consultation peut donc se révéler judicieuse. Consultation, dont en l’occurence, le résultat fut sans appel : la jarre doit rester la jarre, fut-elle inutile. Dont acte, l’olivier ira au jardin, dut-il souffrir en hiver.
L’aspirateur à main

Si l’on fait partie des hommes qui détestent les aspirateurs et préfèrent utiliser un balai pour assurer le sommaire ménage quotidien, il est une solution pour, de temps à autre chasser la poussière des recoins, rendre un peu de lustre aux étagères ou au piano. Le petit aspirateur à main, sans fil et pas trop bruyant. Toujours à disposition sur son chargeur, c’est un outil précieux, qui ne remplace certes pas le Dyson préféré des ménagères – cet animal rugissant, ce dragon insaisissable et pervers dont le jeu préféré consiste à se rouler en boule et à fermer toutes ses écoutilles pour surtout ne pas être vidé – mais peut assurer 90% du travail des machines infernales habituellement utilisées.
La nappe déperlante

Lorsque l’on est pas le roi de la lessive, exercice hautement périlleux quand s’agit de laver du linge de maison (quelle température pour quel type de linge ? quel risque de retrouver tout le linge teinté de rose parce que vous avez eu la mauvaise idée d’ajouter un T-shirt teint à la main aux draps ?) la solution peut être de choisir une nappe déperlante. En fait une nappe en coton enduite d’une couche d’on-ne-sait-quoi étanche, qui autorise de passer l’éponge après le repas. L’avantage esthétique est indéniable par rapport à la bonne vieille toile cirée. L’inconvénient est le prix – assez élevé – et le fait qu’il faut limiter les passages en machine, au risque de perdre à la longue ses vertus déperlantes. Mais le castor senior conseille quand même. Cela permet de donner l’illusion d’un standing maintenu malgré l’absence de toute fée du logis.