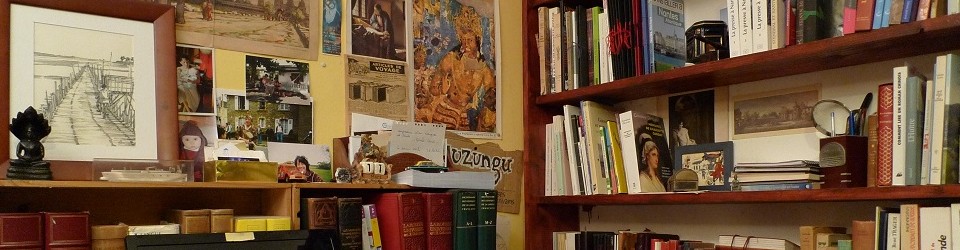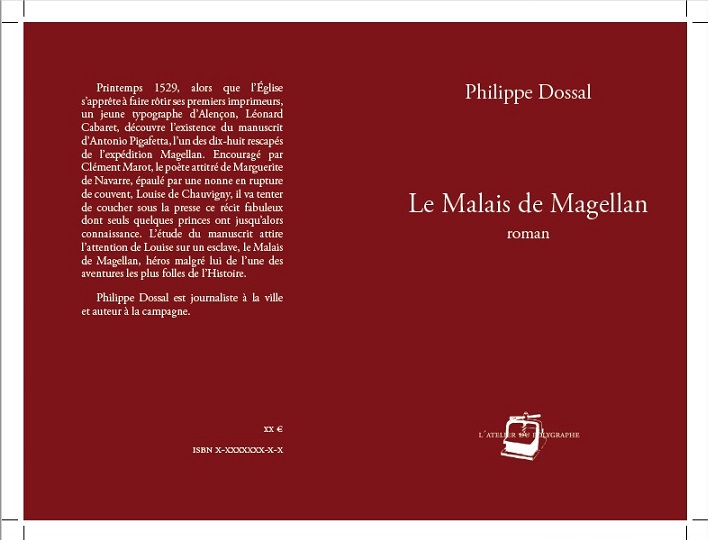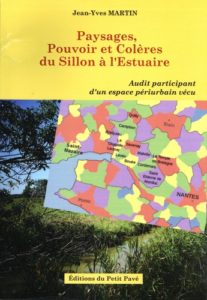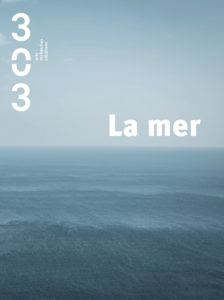10 – La Cave aux bœufs
Louise écrit à Léonard. Clément en possession du manuscrit de Pigafetta. Une visite de Claude Garamont. La bibliothèque de Marguerite livre quelques secrets. Léonard fait un pas de côté à La Cave aux Bœufs.
Léonard,
M’auriez-vous ensorcelée ? Je vais finir par me poser la question. Il ne se passe plus une heure, depuis votre évocation de Magellano, sans que mon attention ne quitte les prairies enneigées d’Avoise pour s’envoler vers les mers océanes, sans que le gémissement d’une branche ne me suggère le craquement de la coque d’un navire. Moi qui n’ai jamais vu la mer – comme je vous envie –je n’ai désormais qu’une hâte, celle de prendre connaissance du récit de Pigafetta, d’entendre la voix de cet Italien nous parler des terres nouvelles où prospèrent des plantes inconnues, des bêtes fabuleuses, où les sauvages vivent à l’état de nature.
Vous me pardonnerez, je l’espère, la liberté prise de consulter Clément lorsque que vous aurez pris connaissance des nouvelles que je viens de recevoir. Notre poète, qui me répond sur le chemin de Fontainebleau, a obtenu de Marguerite un billet demandant à la reine mère de lui confier le manuscrit afin d’en réaliser une copie pour sa librairie d’Alençon. Vous lisez bien : il le tient dans ses bagages et sera bientôt en mesure de nous le confier, enfin de vous le confier, même si je vous supplierai bien entendu, le moment venu, de me laisser le lire. Clément ajoute une histoire étonnante. Il semble que Pigafetta ait disparu à Venise après avoir vainement tenté de faire éditer lui-même ce récit. Comme si certaines autorités redoutaient que la représentation du monde soit mise en question par cette publication.
Il va falloir vous préparer à partir pour Caen, Bayeux ou l’abbaye du Mont Saint-Michel, c’est l’itinéraire qui se dessine pour la cour sur le chemin de la Bretagne. Le royal équipage doit ensuite passer quelques semaines à Chateaubriant, chez Françoise de Foix, à qui le roi voue une grande affection (en dépit de la jalousie maladive de son mari, Jean de Laval, me précise, cabotin, Clément). A ce propos, je me dois de vous préciser une chose, Léonard, en sorte qu’aucun malentendu ne s’installe entre nous. Clément me confie à vos bons soins avec une insistance trop appuyée pour être tout à fait honnête. Il devrait pourtant savoir que je ne suis pas libre de mes élans et que dame Cécile me cherche actuellement un mari. Je ne sais pas si je le souhaite mais je suis sûre d’une chose, je ne veux à aucun prix retourner au couvent.
Mais je m’égare. Ayez la gentillesse de jeter ce billet au feu après l’avoir lu. Je passerai vous voir jeudi, dans votre antre au château. En attendant je vais rêver de sifflement dans les voiles, de poissons volants et d’îles inconnues.
Votre amie, Louise de Chauvigny
« Il n’est pas question que tu nous quittes avant que nous ayons achevé Le miroir de l’âme pêcheresse. J’ai promis à la duchesse de lui livrer un premier lot pour Pâques.» Maître du Bois n’est pas content, pas content du tout « je me permets de te rappeler que tu nous a abandonnés cinq semaines à la fin de l’été, causant un grand retard dans nos livraisons. Cette imprimerie n’est pas un moulin où l’on vient travailler quand l’envie nous prend. » Léonard se doutait qu’il serait difficile d’arracher un prochain congé à Maître du Bois, mais il lui fallait tenter le coup. Tant pis, il devra attendre quelques semaines et sera sans doute contraint de pousser jusqu’à Chateaubriant pour retrouver Clément. Mais il aura, en échange, un beau prétexte : prendre avec lui les premiers exemplaires du livre de Marguerite, ou, à tout le moins, un jeu d’épreuves, et les soumettre à Clément, qui pourra procéder à de précieux arbitrages. Il n’est pas simple de composer dans une langue vivante, mouvante, dont l’orthographe, la ponctuation, la grammaire même, manquent d’assise, se cherchent d’une formule à l’autre, d’une page à la suivante. Le travail n’en est pas moins passionnant, a fortiori depuis que l’atelier a acquis une fonte complète de caractères romains, comprenant une variation à l’italienne, certains parlent d’italiques, réalisée par Daniel Augereau à Paris. C’est le jeune apprenti de ce graveur réputé, un certain Claude Garamont, qui est venu livrer la marchandise, passionné comme Léonard par l’évolution de la graphie. « J’aimerais, à mon tour, créer une nouvelle fonte » a confié le jeune homme le soir de sa venue, devant une chopine aux Sept colonnes « mais je vois l’œil de la lettre un peu plus grand et l’ensemble un peu plus souple, j’ai l’idée de doter les empattements d’une petite voûte sous la plante des pieds, pour donner l’impression au lecteur que les lettres marchent à pas de loup sur la ligne. »
Le vent peut bien passer sous les portes, l’encre geler dans l’encrier, les mains blanchir sous les gants de peau, Louise ne déroge plus, chaque jeudi, à la visite rituelle qu’elle effectue désormais à la librairie du château. Les deux jeunes gens s’y retrouvent à l’abri des regards pour échanger les bribes d’informations qu’ils ont pu recueillir au cours de la semaine. Léonard en épluchant les quelques rares récits de voyages en nouvelle Espagne de la bibliothèque, Louise en multipliant les échanges de courriers avec les relations qu’elle entretient à la cour de Navarre. La chambrière a choisi de s’installer dans la bibliothèque de Léonard plutôt que dans son lit. Ce qui lui permet de participer activement à ses recherches, qui sont désormais devenues leurs recherches, et de partager sa compagnie sans s’exposer aux dangers que supposerait une relation charnelle. Enfin, c’est ainsi qu’elle voit les choses. Léonard, à la fois étonné et ravi de la tournure que prend ce compagnonnage, laisse faire et observe. L’imprimeur ne veut surtout pas insulter l’avenir, un avenir dont les contours ne cessent de se modifier et dans lequel il a renoncé à se projeter.
Ce jeudi c’est par un biais inattendu que leur approche du voyage de Magellano s’enrichit singulièrement. « J’en ai parlé incidemment à Frotté cette semaine », explique Léonard assis en équilibre sur son coin de table « et je comprends mieux maintenant les raisons pour lesquelles le récit de Pigafetta n’intéresse personne, ou, à tout le moins, pas grand monde. » Louise, qui tente de se réchauffer en sautant d’un pied sur l’autre, les fesses collées à la cheminée, l’invite du regard à poursuivre. « Frotté a entendu parler de cette affaire lors d’un conseil restreint du roi consacré à la façon de s’affranchir du traité de Tordesillas. Il s’agissait de permettre à nos marins de pousser au-delà des Terres Neuves. Ce traité, tu le sais, a divisé les terres à découvrir entre les royaumes d’Espagne et du Portugal. Frotté se souvient que ce Magellano était considéré comme un traitre à sa patrie, le Portugal, qui s’était trompé sur la situation des îles Malucques en empruntant un chemin beaucoup trop long pour les atteindre, et avait échoué dans sa mission. Sans compter le fait qu’il avait péri en chemin. Un aventurier sans intérêt donc. Infréquentable qui plus est. »
Léonard a maintenant labouré les quelques ouvrages évoquant la conquête espagnole des Indes Occidentales et les premiers pas des Portugais en Asie et commence à se faire une idée un peu plus précise de la configuration des terres émergées. Sa bible est devenue la Suma de Goegrafia, de Martin Fernandez de Enciso, un atlas espagnol que Marguerite a rapporté de Madrid lors de son voyage pour négocier la libération du roi, son frère. Le jeune homme ne comprend pas tout aux notations en espagnol, aux conseils de navigation, et voit bien que les contours des îles, le dessin des continents, s’estompent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’Europe, mais il se fait à l’idée petit à petit que la terre est vraiment ronde ainsi que le prétendaient les Grecs et que l’affirme Ptolémée, dont Marguerite possède une splendide traduction manuscrite, issue de la librairie de son père. « Arrête donc de te torturer les méninges et viens respirer le bon air de l’hiver » lui lance Guillaume dont la silhouette se découpe dans l’encadrement de la porte de la librairie. Louise est partie depuis bien longtemps, et Léonard se rend compte qu’il n’a pas vu le temps passer, absorbé par la contemplation de l’atlas de Fernandez. « Tu ne vas pas t’encalminer dans cette librairie. Il faut sortir un peu. J’ai quelque chose à te proposer. Puisque ta Louise joue les princesses, viens donc avec moi à La Cave aux Bœufs, il y a une excellente bière et quelques donzelles pas trop farouches qui seront ravies d’entamer une conversation avec un garçon ayant ses entrées au château. »
Ce n’est pas une taverne mais une étuve dans laquelle Guillaume conduit Léonard par les rues éteintes de la ville. Comme si l’humidité de la nuit normande s’était transformée en vapeur au contact de la chaleur animale qui se dégage des corps dans ce bouge au plafond si bas que l’on se croit obligé de courber en permanence les épaules. Mais on se familiarise vite avec cette moiteur épaisse qui fait tomber les manteaux et découvre les épaules des filles, pour peu que la bière soit bonne et l’accueil chaleureux. « Nous amènerais-tu du beau monde Guillaume ? » lance, un brin ironique, l’avenante matrone après avoir jeté un œil expert sur la tenue de Léonard, vêtu du pourpoint couleur taupe qu’il s’est fait tailler à Rouen, habilement coupé pour monter à cheval. « En quelque sorte » répond le graveur, souriant. « Un garçon un peu trop absorbé par ses travaux en ce moment et qui a grand besoin de se détendre » ajoute-t-il sibyllin. « Asseyez-vous donc et prenez-vos aises, je crois avoir un excellent remède pour ce genre de mal ». De fait, un remède de chair débordante, d’attentions savamment appuyées et de cheveux roux ne tarde pas à se présenter à la table des garçons. La gironde Gertrude, dont l’accent grasseyant trahit des origines germaniques, se pose vite en parfaite diversion mentale pour Léonard dans cette atmosphère vaporeuse, et permet à Guillaume de s’éclipser discrètement pour retrouver une bande de compagnons tailleurs. Et c’est apaisé et ragaillardi que Léonard regagne l’imprimerie le lendemain matin, allégé d’un poids et débarrassé d’un élan qui lui cannibalisait l’esprit et commençait à parasiter son regard porté sur Louise. Et puis après tout, madame la princesse ne l’a pas attendu pour faire des folies de son corps. Voilà qui remet les choses en place, même s’il entend bien se garder de la moindre confidence. L’épisode s’il fut délicieux n’est pas des plus glorieux. « Nous nous garderons d’en faire l’article » lance-t-il le lendemain soir à Guillaume, en arborant un sourire complice, lors de leur sage retour aux Sept Colonnes.