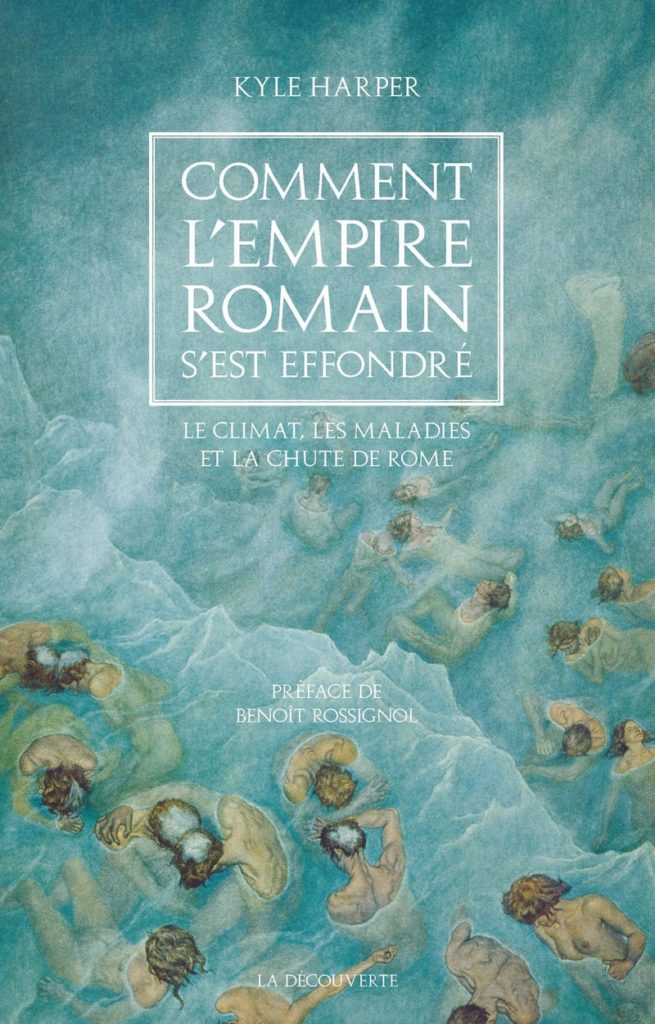Archives de l’auteur : Philippe
Se faire la malle
C’est un exercice étrange et délicieux que de composer son bagage pour un long voyage. La contrainte est ici de faire entrer dans quatre cantines métalliques (soit un mètre cube) le nécessaire et le suffisant pour vivre un an ou deux sous d’autres cieux, en l’occurrence Mayotte. J’adore ce genre de contrainte, qui oblige à s’interroger sur ce que l’on considère comme indispensable pour couler des jours paisibles.
La priorité va à la bibliothèque et au bureau. Pour des raisons pratiques et parce que je ne sais pas si je disposerai d’un logement meublé, j’ai choisi d’utiliser des caisses de vin en bois, héritées de mon passé de bouquiniste, pour transporter les livres. Cela permettra au besoin de composer une étagère verticale avec ces quatre caisses empilées. La caisse de littérature est déjà saturée, celle de philo hésite encore un peu, tout comme celle de voyages et la caisse dévolue à l’histoire. A qui fera-t-on appel le moment Venu. A Montaigne, à Cioran, à Nicolas Bouvier ou à Tchekov ? Pour l’heure Proust est de la partie mais reste encore un petit mois pour effectuer les derniers arbitrages, avant de livrer les malles au transitaire maritime. Côté bureau, le matériel de dessin va occuper une place de choix. Mon ami Claude m’a appris à rehausser les dessins à l’aquarelle et j’entends bien illustrer les carnets que je ne manque pas d’emporter. Quelques petits objets symboliques vont aussi prendre place dans cette malle, histoire d’être entouré de quelques figures familières, tel un petit buste de Borgès ou un bouddha cambodgien.
Une seconde cantine devra contenir le nécessaire pour cuisiner. De ce point de vue pas d’inquiétude, il y a l’embarras du choix, la maison en est pleine. Les garçons devront toutefois se priver de ma magnifique sauteuse et de mon légendaire couteau de cuisine. Pour le reste je n’entends pas piller le patrimoine commun, et me contenterai de vaisselle et d’ustensiles de second choix. Ne pas oublier un petit mixer, et une passoire. On en trouve à Mamoudzou, mais c’est hors de prix et je risque d’être éloigné de la capitale, que je n’ai pas l’intention de fréquenter assidûment.
La vieille cantine sera, quant à elle dédiée aux outils. Histoire de pouvoir construire, au besoin, quelques étagères, ou un peu de mobilier sommaire en utilisant du bois de palettes. La dernière devrait être consacrée aux jeux et aux jouets que tout hôte qui se respecte doit détenir pour recevoir de jeunes enfants. Ce qui sera le cas avec ma tribu de petites filles. Le linge de maison, quelques coussins et peut-être un fauteuil pliant seront répartis dans les différentes malles pour caler l’ensemble du matériel, appelé à descendre les côtes de l’Afrique en porte-conteneur. Les vêtements – il en faut très peu – pourront quant à eux voyager en avion avec leur propriétaire le moment venu.
J’oublierai certainement quelque ustensile capital (damned un tire-bouchon), c’est le jeu (penser à un sèche-cheveux pour combattre l’humidité chronique dans les chaussures à la saison des pluies). Mais c’est un grand plaisir que de composer ainsi son bagage. On s’imagine Stevenson partant pour les Samoa ou Stanley préparant son expédition en Afrique. C’est, certes, un peu exagéré, mais tellement sympa à préparer.
Bon été à tous. Le départ des malles est prévu fin juin, celui de l’animal mi-septembre.
Mayotte sans filtre
“Pauvreté endémique” les premières lignes d’un récent papier du Monde reçu de mon amie Catherine ne dérogent pas au cliché qui colle à la peau de Mayotte, cette poussière d’Empire, où j’achève un séjour de trois mois – dans le centre et sur la côte ouest de l’île. Ce n’est évidemment pas faux, mais c’est un peu plus “un peu plus compliqué que ça” comme dirait François Morel. Quelques lignes donc pour proposer un regard un peu moins caricatural qu’il ne semble l’être dans les rédactions parisiennes et plus généralement en France métropolitaine (sachant que je n’ai pas accès au papier complet du Monde).
Tout d’abord Mayotte est un site naturel exceptionnel, une des îles les mieux loties de l’Océan Indien, qui joue dans la catégorie des Seychelles et de Zanzibar. L’hyppocampe que forme l’île est ceinturé par une double barrière de corail où prospère une faune remarquable : des tortues géantes qui viennent lécher les plages et une variété de poissons peuplant les coraux que l’on peut observer à loisir à fleur de surface. Le littoral est peu accessible, les plages ne sont pas aménagées, il y a un peu de pollution superficielle (essentiellement des déchets) mais pas de problème systémique en raison de l’absence d’industrie. C’est un vrai vrai bonheur pour qui accepte de dévaler quelques pentes pour gagner les plages. L’absence de tourisme participe sans doute de la préservation de ce cadeau de la nature, de ces plages bordées de cocotiers où l’eau est translucide. Sur terre, ou plutôt dans les airs, les makis, ces lémuriens fantasques assurent l’ambiance en familles.
Mayotte est aussi l’île des épices et des parfums, de la vanille de l’Ylang-Ylang. Guerlain y a longtemps possédé d’importantes plantations avant de partir pour les Comores. C’est plus généralement le sanctuaire d’une agriculture ancestrale, intelligente, qui conjugue sur une même parcelle des cultures étagées, tenant compte de la lumière et de l’humidité, patate douce, plants d’ananas, pieds de bananiers, le tout entouré de cocotiers, de manguiers ou de jacquiers. Ce type d’agriculture est malheureusement en déclin mais l’île produit elle-même atour de 70% de ses besoins alimentaires. Rares sont les régions qui peuvent en dire autant.
L’île est officiellement peuplée de 250 000 habitants, mais dans les faits on s’accorde à penser qu’il y en a le double. Des résidents sans papiers, pour la plupart Comoriens, attirés par les lumières de Mayotte et le niveau de vie extravagant à leurs yeux des Mahorais (les natifs de Mayotte) intégrés, et des Métropolitains, pour la plupart enseignants, policiers, infirmières ou médecins, bénéficiant de salaires supérieurs de 40% à ceux pratiqués en métropole. La France et l’Europe tentent ainsi de s’acheter la paix sociale dans ce territoire isolé, au large de Madagascar.
Le résultat de cette politique (la départementalisation a dix ans) est assez étrange. D’un côté l’île est sillonnée de gros 4X4, tous plus rutilants les uns que les autres, les maisons luxueuses poussent à grande vitesse, les équipements se multiplient. Et de l’autre les bidonvilles se déploient, les cases en tôle colonisent les abords des villes, où des dizaines de milliers de résidents sans papiers tentent de survivre en échappant aux contrôles. Le paradoxe est que ce sont eux qui font tourner l’île, notamment l’agriculture et le bâtiment. Payés à coup de lance-pierre (une femme de ménage touche de l’ordre de 150€ au noir), ils sont en quelque sorte le petit personnel de la communauté.
L’une des clefs de compréhension de cette situation est, comme bien souvent, liée à l’histoire du lieu. Mayotte semble avoir été, avant d’avoir choisi son rattachement à la France, la moins considérée des quatre îles qui composent l’archipel des Comores (lequel ne reconnait toujours pas le démantèlement politique de l’ensemble). Cela pour des raisons qui, honnêtement, m’échappent, liées aux différences de culture entre les îles. Ce retournement de fortune explique en partie les tensions qui opposent les communautés, et le côté hyper nationaliste des Mahorais, qui votent volontiers Rassemblement National et considèrent que le gouvernement français est beaucoup trop laxiste en terme d’immigration clandestine.
La natalité galopante (la maternité de Mamoudzou est la plus importante de France, plus de 10 000 naissances par an), l’application du droit du sol aux enfants nés sur l’île de parents étrangers, participent d’une situation sociale explosive, en raison notamment de la présence de centaines d’enfants et d’adolescents livrés à eux-mêmes, qui n’ont d’autre ressource pour vivre que de ramasser les miettes du festin, voire de se servir (les maisons sont dotées de portes métalliques et de grilles). Pendant le confinement, le lycée agricole de Coconi était pillé pratiquement toutes les nuits par des voleurs de poules ou de canards, qui cherchaient tout simplement à manger, faute d’activité.
L’île n’en est pas moins un paradis tropical, où se superposent, sans souvent se recouvrir, les cultures africaines, malgaches, indiennes et européennes. L’une de ses particularités est la culture matriarcale : ce sont les femmes qui possèdent le patrimoine, et elles se le transmettent entre femmes. Cela n’empêche pas, dans cette île musulmane à 98% – un islam africain, assez doux – la pratique de la polygamie. Avoir plusieurs femmes est encore un signe extérieur de réussite, comme posséder une grosse voiture.
Il faudrait, naturellement beaucoup plus de temps prétendre comprendre les enjeux, pénétrer les mystères de cette mosaïque singulière qui s’est construite depuis deux siècles dans un rapport ambigu à l’Occident et à la France en particulier. Mais la réduire à un caillou souffrant d’une pauvreté endémique, secoué par une violence perpétuelle, est une représentation plus qu’abusive. C’est une île plaisante à découvrir, peuplée de gens charmants quand ils sont de bonne humeur, pour qui apprécie la nonchalance africaine et n’est pas trop effrayé par l’humidité tropicale, les petites bêtes, et l’imprésivibilité des évènements.
Protégé : Mayotte quatrième
Les fonctionnaires fantômes de Mayotte
Les fonctionnaires de la préfecture de Mayotte ont des titres étonnants. Il existe par exemple un “Chef de la mission fraude départementale, Secrétaire général”. Il s’agit peut-être d’un titre honorifique ou d’un ornement sur une carte de visite, parce que le susdit fonctionnaire, s’il est doté d’un titre à rallonge, n’est pas extrêmement véloce lorsqu’il s’agit de faire preuve de ses talents.
Il étudie ainsi depuis dix-huit mois, le dossier d’une voiture – feu la mienne en l’occurence, une première main munie de tous ses papiers – expédiée par bateau en 2019 depuis Saint-Nazaire – pour savoir s’il va daigner lui accorder une carte grise. Il n’était pas certain que c’était que c’était la bonne voiture. Scrupuleux, il a donc diligenté un inspecteur des services de l’Etat, pour ausculter l’animal, vérifier les caractéristiques, les numéros de plaque, de moteur, la couleur de la robe, le moëleux des sièges. Il a eu accès au carnet de santé de la machine, ses révisions, ses vaccinations. Tout était parfait.
Un an plus tard, en dépit d’incessantes relances, d’heures d’attente au téléphone, de courriels inquiets, pas l’ombre d’une nouvelle, pas la moindre trace de vie dans le bureau de ce secrétariat général fantôme. De passage sur l’île, j’ai tenté ces dernières semaines de débrouiller l’affaire (cette voiture qui n’est plus la mienne, mais pas encore celle de mes enfants, roule sans papiers, faute de carte grise). Et en l’absence de réponse du secrétariat général de la mission fraude départementale, j’ai confié mon désarroi à un confrère, rencontré lors d’un précédent séjour, journaliste sur l’île.
Voilà deux semaines, les “Nouvelles de Mayotte” ont relaté l’affaire (accroche de Une “L’impossible carte grise”, pleine page expliquant le malaise, et évoquant même la possibilité d’un trafic de cartes grises), à la suite d’un entretien avec Dominique Voynet, la directrice de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Rien, pas une réaction de la préfecture, en dépit d’une relance quelques jours plus tard de la directrice de cabinet du préfet.
Que faire de plus, que dire, qui alerter ? Pour l’heure la solution adoptée est simple. En lieu et place de la carte grise (la voiture est assurée), les gendarmes trouveront une copie de ‘L’impossible carte grise” des Nouvelles de Mayotte. Peut-être auront-ils plus de chance qu’un citoyen ordinaire et sauront-ils trouver, voire réveiller le Secrétaire général de la mission fraude départementale. En théorie il n’est pas à la plage parce que l’île est confinée. Mais il ne faut jurer de rien dans cette île aussi jolie que fantasque.
Protégé : Mayotte troisième
Protégé : Mayotte deuxième
Protégé : Mayotte première
Le climat, les épidémies et la chute de Rome
“Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre” écrivait Goethe (enfin c’est ce que prétendent mes carnets). La formule pourrait figurer en quatrième de couverture de l’ouvrage que nous occupe ici Comment l’Empire Romain s’est effondré tant cet essai de l’Américain Kyle Harper provoque le vertige. Précisons qu’il a été écrit en 2017 et publié en France début 2019, quelques mois avant l’apparition de la Covid19 (nous dirons la Covid pour faire plaisir à l’Académie). Il ne s’agit donc pas d’un essai opportuniste mais d’un réel travail scientifique, indépendant du contexte pandémique que nous connaissons.
Précision liminaire, je suis en cours de lecture, et le déchiffrage de ce pavé, 540 pages avec les notes, va me prendre un peu de temps. Je suis un lecteur lent, c’est ainsi. Et je sais que le temps est le prix à payer pour éclairer sérieusement la pensée. Mais je ne suis pas inquiet, la préface et les premiers chapitres de l’ouvrage montrent toute la rigueur scientifique de ce travail, écrit à la lumière des récentes découvertes sur l’histoire du climat et le développement des pandémies au cours de l’Antiquité tardive.
Donc, donc ces précisons apportées, venons en au fait. Contrairement à une idée reçue, Rome se portait bien en 400, dix ans avant son sac par les Wisigoths. La ville comptait 700 000 habitants et jouissait de tous les avantages d’une ville classique à l’échelle impériale, même si les empereurs n’y vivaient plus. Selon un état des lieux datant du IVe siècle On y dénombrait 423 quartiers, 44 602 habitations, 290 greniers, 856 bains, 28 bibliothèques et… 46 bordels. Bref, une ville prospère, comme put le constater l’Empereur et son consul au tout début de l’an 400, salués par une série de fastueuses cérémonies. “Grâce au discours du poète Claudien, nous savons que l’on a offert au peuple toute une ménagerie exotique qui reflétait bien les prétentions globales de l’Empire.” relève Kyle Harper.
On est loin donc de la perception classique du lent déclin de l’Empire Romain, popularisée par le grand historien Gibbon au XIXe siècle et de son Histoire de la décadence et la chute de l’Empire Romain (ouvrage néanmoins passionnant, que j’ai lu en son temps sur la recommandation de Borgès). Kyle Harper revisite entièrement le mythe à la découverte de récentes avancées scientifiques, qui révèlent la fin d’un l’optimum climatique atteint au IVe siècle, lequel, plus humide, avait été une bénédiction pour toute la région méditerranéenne et avait présidé au développement de la ville et de l’Empire.
“Les changements climatiques ont favorisé l’évolution des germes, comme Yersina Pestis, le bacile de la peste bubonique” commente l’éditeur. “Mais les Romains ont aussi été les complices de la mise en place d’une écologie des maladies qui ont assuré sa perte. Les bains publics étaient des bouillons de culture, les égoûts stagnaient sous les villes, les greniers à blé étaient une bénédiction pour les rats, les routes commerciales qui reliaient tout l’Empire ont permis la propagation des épidémies de la mer Caspienne au mur d’Hadrien avec une efficacité jusque la inconnue. Le temps des pandémies était arrivé.”
Cette lecture des évènements est étayée par une multitude de recherches contemporaines, rendues possibles grâce, notamment, à une précision nouvelle du carottage des glaces et au développement de la dendrochronologie (méthode scientifique permettant la datation des pièces de bois à l’année près en analysant les anneaux de croissance). Comme tout essai argumenté qui se respecte, l’ouvrage de Kyle Harper est truffé de références, n’hésite pas à fouiller la profondeur historique, relatant notamment l’épisode de la peste antonine, qui fit 500 000 morts au IIe siècle et dont le célèbre Galien fut témoin.
Qui plus est, le bouquin est fort bien écrit, très vivant et semble bien construit. C’est donc une recommandation sans réserve aucune, même s’il faut un peu de courage pour s’y atteler. Pour ma part j’alterne, comme à l’accoutumée, avec d’autres lectures et j’envisage de l’emporter avec moi dans les îles où j’ai prévu de passer l’hiver, (au grand dam j’imagine de Catherine B. qui me l’a recommandé et prêté, qu’elle en soit ici remerciée) et qui risque de ne pas le revoir avant le printemps . Histoire de revenir un peu plus averti, et peut-être, de poser un regard un peu moins effaré sur l’étrange période qui s’ouvre à nous.