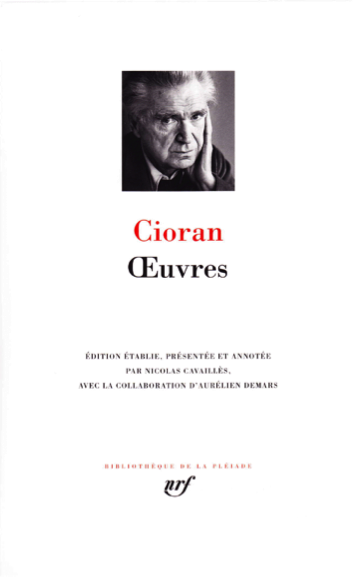C’est une étrange opération de l’esprit que celle de plonger dans un autre univers linguistique que le sien. Plus déstabilisante que celle de changer de costume ou de maison. Une espèce de prévention inconsciente nous retient, nous souffle à l’oreille que c’est décidément trop difficile, qu’on n’y parviendra pas, malgré les années passées à étudier la grammaire anglaise ou allemande sur les bancs de l’école.
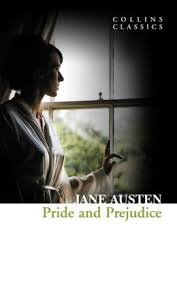 Curieusement, je n’ai jamais eu ce genre de prévention à l’oral. Question de tempérament sans doute, et d’origine aussi : la Normandie bénéficie d’une proximité historique et géographique avec l’Angleterre, qui a toujours favorisé les échanges entre les deux rivages de la Manche. Je viens, ainsi, de découvrir que Jane Austen avait passé une partie de sa vie à deux pas de Basingstoke, la petite ville anglaise jumelée avec Alençon, où j’ai séjourné, collégien. Et puis j’aime la musique de l’anglais, la plasticité de cette langue, beaucoup plus souple et déliée que ne l’est le français. Pour être honnête, je suis plutôt un praticien, à l’oral, de l’anglais de Yasser Arafat. Cet anglais basique, débarrassé de son accent tonique, ce plus petit dénominateur commun qui sert de langue véhiculaire sur une grande partie de la planète, cette espèce de Land Rover de l’expression, qui permet de se faire comprendre en Tanzanie comme en Inde, en Russie comme au Laos.
Curieusement, je n’ai jamais eu ce genre de prévention à l’oral. Question de tempérament sans doute, et d’origine aussi : la Normandie bénéficie d’une proximité historique et géographique avec l’Angleterre, qui a toujours favorisé les échanges entre les deux rivages de la Manche. Je viens, ainsi, de découvrir que Jane Austen avait passé une partie de sa vie à deux pas de Basingstoke, la petite ville anglaise jumelée avec Alençon, où j’ai séjourné, collégien. Et puis j’aime la musique de l’anglais, la plasticité de cette langue, beaucoup plus souple et déliée que ne l’est le français. Pour être honnête, je suis plutôt un praticien, à l’oral, de l’anglais de Yasser Arafat. Cet anglais basique, débarrassé de son accent tonique, ce plus petit dénominateur commun qui sert de langue véhiculaire sur une grande partie de la planète, cette espèce de Land Rover de l’expression, qui permet de se faire comprendre en Tanzanie comme en Inde, en Russie comme au Laos.
En revanche, à quelques rares exceptions, je ne m’étais guère jusqu’alors frotté aux grands textes britanniques. Trop pauvre en vocabulaire, pensais-je, pour ne pas souffrir immodérément et perdre ainsi le plaisir de la lecture. Les journaux passent encore, quelques articles ici ou là et deux ou trois ouvrages, dont un Somerset Maugham de belle mémoire. Mais, sans doute par fainéantise, jamais mes auteurs de langue anglaise favoris, que sont Robert-Louis Stevenson ou Joseph Conrad.
Encouragé, et piqué au vif sur ce blog par quelques lectrices anglophiles, me voici aujourd’hui plongé dans « Pride and Préjudice » de Jane Austen, en anglais dans le texte, acquis la semaine dernière, en poche, chez Coiffard à Nantes. L’affaire commençait mal : « It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. » Il me semblait comprendre le sens de cette première phrase, sans toutefois connaître le sens précis de “acknowledged”. Mais si je m’arrêtais à chaque mot, on n’en sortirait jamais.
J’ai donc adopté une technique toute simple pour les premiers chapitres. Une première lecture en anglais, acceptant les éventuelles imprécisions dues à l’incompréhension de quelques mots, puis une relecture en français dans la traduction de La pléiade pour vérifier que je n’avais pas fait de contre sens. J’étais terrorisé à l’idée de ne pas goûter à la qualité des dialogues de Jane Austen, de passer à côté des traits d’esprit qui émaillent le texte, et qui en font tout le sel.
Et, au bout d’une dizaine de ces courts chapitres, la magie a peu à peu opéré, et la relecture est devenue presque superflue. Me voilà désormais plongé dans l’univers linguistique britannique de la fin du XVIIIe, ce versant de la langue que l’on nous apprenait à l’école, où les racines latines sont encore très nombreuses et facilement intelligibles. Où cet humour anglais, tout en subtilité et en retenue, se déploie en version originale. Et puis j’adore ce genre de raccourci que l’anglais se permet « you can but see one of my daughters… ». Ce but me botte parce qu’il résume toute la souplesse de langue, qui s’embarrasse assez peu de grammaire.
Pardon d’avance aux anglophones et anglophiles de passage qui décèleront ici toute la naïveté du propos, mais nous dirons, pour nous faire pardonner, que ce billet s’adresse plutôt aux lecteurs qui n’osent pas franchir le pas. Comme pour apprendre à nager, le plus simple est peut-être de se jeter à l’eau.
Série d’été, cette chronique a été publiée une première fois en janvier 2014