« Il n’y a qu’en littérature qu’on ne parle pas d’interprétation. En musique on interprète Mozart ou Beethoven, au théâtre Shakespeare ou Tchekov. En littérature, c’est la même chose, chaque traduction est une interprétation». C’est en ces termes – ou à peu près, puisqu’André Markowicz l’a rappelé opportunément, la distance entre le français parlé et le français écrit est assez grande – qu’André Markowicz donc, a répondu ce vendredi 7 novembre à une question posée sur le supposé vieillissement d’une traduction, au terme d’une conférence ébouriffante à la médiathèque de Nantes. En d’autres termes, la question n’a pas grand sens, chaque traduction est une aventure en soi.
 Le traducteur de Dostoïevski pour les éditions Actes Sud a toutefois esquissé une piste pour expliquer l’impression « datée » que peuvent laisser certaines traductions. Selon lui, les traductions d’œuvres étrangères ont longtemps consisté à « rendre en français » des textes écrits dans une autre langue. En essayant de faire entrer une sensibilité, une pensée étrangères dans les clous de notre langue écrite. Or « c’est le chemin inverse qu’il faut emprunter » : c’est à la langue française d’aller chercher dans ses replis la meilleure façon d’exprimer ce que l’auteur a exprimé dans sa propre langue, usant et abusant au besoin des répétitions, ce tabou français. Ce n’est pas simple parce qu’il faut malgré tout respecter la grammaire. « La grammaire c’est le vivre ensemble ».
Le traducteur de Dostoïevski pour les éditions Actes Sud a toutefois esquissé une piste pour expliquer l’impression « datée » que peuvent laisser certaines traductions. Selon lui, les traductions d’œuvres étrangères ont longtemps consisté à « rendre en français » des textes écrits dans une autre langue. En essayant de faire entrer une sensibilité, une pensée étrangères dans les clous de notre langue écrite. Or « c’est le chemin inverse qu’il faut emprunter » : c’est à la langue française d’aller chercher dans ses replis la meilleure façon d’exprimer ce que l’auteur a exprimé dans sa propre langue, usant et abusant au besoin des répétitions, ce tabou français. Ce n’est pas simple parce qu’il faut malgré tout respecter la grammaire. « La grammaire c’est le vivre ensemble ».
Prenant un exemple tout simple, il s’est appuyé un instant sur la locution « je ne sais pas ». Il y a des tas de façons de l’exprimer à l’oral en français « je sais pas », « chai pas », « j’en sais rien, moi »… mais une seule à l’écrit. D’autres langues, le russe notamment, autorisent ces nuances. Comment alors faire alors, pour ne pas laisser filtrer une familiarité qui ne ferait pas partie de la proposition originale ? Comment traduire pravda, qui peut contenir à la fois les notions de vérité et de justice, dans telle ou telle circonstance ? André Markowicz, relève, au passage, que le même problème se pose en breton, idiome qu’il maitrise aussi parfaitement, d’évidence.
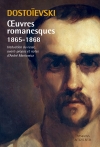 Chaque mot, chaque phrase peut ainsi devenir un casse-tête. Mais André Markowicz, justement, ne se prend pas la tête ; il traduit « comme on conduit une voiture », sans se poser de questions, dégagé des contraintes techniques, parce qu’il a eu la chance de disposer, en Russie, d’un maître en traduction, à la manière d’un instrumentiste qui domestique la technique aux côtés d’un maître de musique. « C’est peut-être ce qui a longtemps manqué en France, une véritable école de la traduction. »
Chaque mot, chaque phrase peut ainsi devenir un casse-tête. Mais André Markowicz, justement, ne se prend pas la tête ; il traduit « comme on conduit une voiture », sans se poser de questions, dégagé des contraintes techniques, parce qu’il a eu la chance de disposer, en Russie, d’un maître en traduction, à la manière d’un instrumentiste qui domestique la technique aux côtés d’un maître de musique. « C’est peut-être ce qui a longtemps manqué en France, une véritable école de la traduction. »
Au-delà des questions techniques, évidemment, il a principalement été question de Dostoïevski, mais aussi de Gogol, l’écrivain qui peut écrire « les malades guérissent comme des mouches » et de Pouchkine. A propos Crime et châtiment « ce livre où tout pue, mais où le mot odeur ne doit pas apparaître une fois » Markowicz a proposé, un décryptage singulier. Les trois piliers en sont, selon lui « le poids, la puanteur et le pas », ajoutant que ce roman nous parle de résurrection, ce qui est extrêmement difficile à rendre parce qu’en français, par définition, on ne peut pas parler de Dieu. Enfin, entendons-nous.
Bref, une conférence ébouriffante, qui donne une furieuse envie de relire Dosto, mais cette fois dans la traduction de Marko, chez Actes Sud.
Photo extraite du blog “Les amis de Paris Saint-Petersbourg”. DR

Exemple du travail de DvM :
Il y a une jolie route qui mène d’Ixopo dans les collines. Ces collines sont couvertes de prairies, vallonnées et plus charmantes qu’on ne saurait dire ou chanter. La route y monte pendant douze kilomètres jusqu’à Carisbrooke et, de là, lorsqu’il n’y a point de brouillard, l’on découvre à ses pieds une des plus belles vallées d’Afrique. Alentour s’étendent herbages et fougères et l’on entend au loin le cri du titihoya, l’un des oiseaux du veld. Plus bas coule l’Umzikulu qui vient du Drakensberg et s’en va vers la mer et, de l’autre côté du fleuve, les hautes chaînes de collines se dressent les unes derrière les autres jusqu’aux montagnes d’Ingeli et d’East Griqualand.
La prairie est riche et touffue, l’on ne voit pas le sol. Elle retient la pluie et le brouillard qui pénètrent dans la terre, alimentant des ruisseaux dans tous les ravins. Elle est bien entretenue, et il n’y a pas trop de troupeaux pour la paître, pas trop d’incendies pour la dévaster. Déchaussez-vous pour y marcher, car cette terre est sacrée et telle qu’elle sortit de la main du Créateur. Protégez-la, gardez-la, nourrissez-la car elle protège les hommes, garde les hommes, nourrit les hommes. Détruisez-la et l’homme est détruit.
L’herbe alentour est riche et touffue et l’on n’aperçoit pas le sol. Mais les riches collines vertes s’interrompent. Elles descendent vers la vallée et, en descendant, changent de nature. Elles deviennent rousses, elles se dénudent ; elles ne retiennent plus la pluie ni le brouillard, et les ruisselets sèchent dans les ravins. Trop de troupeaux en paissent l’herbe et trop d’incendies les dévastent. Chaussez-vous bien pour marcher sur cette terre, car elle est rude et dure et les pierres sont coupantes sous les pieds. Elle n’est point entretenue ni gardée ni nourrie, elle ne protège plus les hommes, ne garde plus les hommes, ne nourrit plus les hommes. Et il y a bien longtemps qu’on n’entend plus ici le cri du titihoya.
Les grandes collines rousses se dressent, désolées, et la terre s’en arrache comme de la chair. Les éclairs flamboient au-dessus d’elle, les nuages se déversent sur elle, et les ruisseaux morts se remettent à couler gonflés du sang rouge de la terre. En bas, dans les vallées, les femmes grattent ce qui reste de terre arable et le maïs atteint à peine la hauteur d’un homme. Ce sont des vallées de vieillards, de femmes et d’enfants. Les hommes sont partis, les jeunes sont partis. Le sol ne peut plus les nourrir.
(fin du livre)
Oui, c’est l’aurore. Le titihoya s’éveille et commence à jeter son cri mélancolique. Le soleil touche de lumière les montagnes d’Ingeli et d’East Griqualand. La grande vallée de l’Umzikulu est encore plongée dans l’obscurité, mais la lumière y pénétrera aussi. Car c’est l’aurore qui s’est levée comme elle se lève depuis un millier de siècles sans jamais y manquer. Mais quand se lèvera l’aurore de notre libération, celle qui nous délivrera de la peur de l’esclavage et de l’esclavage de la peur, cela est un secret.
Pleure ô pays bien-aimé, Alan Paton
(Il faudrait connaître l’original pour mieux voir la qualité du travail de la dame. Savoir, par exemple, si c’est elle qui a inventé ce « délicat « touche de lumière »)
Si je comprends bien, un tâcheron dégrossit, une star fignole ?
J’en profite pour rendre hommage à une grande traductrice : Denise van Moppès.
(Autre traducteur, nantais, lui : un certain Patrick C…)
de mémoire : in Essais de linguistique générale de Jackobson le chapitre (4?) consacré à la traduction.
Je me suis peut-être mal exprimé (et je mesure à la relecture du billet, toute la difficulté de “traduire” pareille intervention). Ce qu’il a voulu dire, il me semble, ce n’est pas que le français manque de nuances, c’est que les traducteurs se sont longtemps réfugiés dans le français, nous dirons académique (il n’a pas prononcé de mot) pour traduire les oeuvres étrangères.
Rappelons qu’à certaine époque, les traductions se faisaient en deux temps. En premier lieu par un traducteur puis étaient réécrites par un auteur français reconnu. Ce fut par exemple le cas pour Conrad, officiellement traduit par Gide, qui parlait à peine anglais.
C’est confus non? ce que j’ai dit tout à l’heure? comme quoi…
Je reprends : il n’y a pas une seule façon de dire “je ne sais pas” à l’écrit, et plusieurs à l’oral, puisque l’écrivain, l’auteur, fait dire à ses/son personnage(s) ce qui convient le mieux pour lui. Le “je ne sais pas” comme signifié, en quelque sorte, devient un “je sais pas”, ou “chai pas” ou “j’en sais rien” comme signifiants, selon qu’il va s’agir de tel(le) ou tel(le)… Zazie ne “parle pas” comme Emma qui ne parle pas comme San Antonio qui ne parle pas comme Béru. Ce qui fait les écrivains, les personnages, le style ou même le ton. Heureusement que pour écrire “je ne sais pas” il y a autant, voire plus pour l’écrivain, de possibilités que pour le dire! L’oral est même infiniment plus pauvre que l’écrit, et non l’inverse. Sinon, il n’y aurait même pas de littérature, ou de livres.
Mais ce n’est pas le problème, ou la question, de la traduction. Car sur ce point, rien à (re)dire aux propos de Markowicz (manquerait plus que ça!)
“Prenant un exemple tout simple, il s’est appuyé un instant sur la locution « je ne sais pas ». Il y a des tas de façons de l’exprimer à l’oral en français « je sais pas », « chai pas », « j’en sais rien, moi »… mais une seule à l’écrit. ”
Non, ps exactement, car les écrire, les transcrire, ces façons “de le dire”, et cela dément ipso facto qu’il n’y a qu’une seule façon de l’écrire…. Et selon que c’est Zazie devant les grilles du Métro, Emma Bovary, San Antonio ou même son Berrurier, autant de façons différentes de l’avoir écrit pour mieux le dire, justement…ou plutôt pour le dire au mieux, au mieux de ce qu’il fallait dire.
Mais, je vois bien ce que Markowicz a pu et voulu exprimer, et je comprends ô combien l’essentiel du propos. Et ce n’est pas pour rien, par exemple, que pour certains textes fondateurs, comme les grands textes de l’Antiquité on préfère (litote) tel ou tel traducteur. Et chaque fois qu’on le peut, pour travailler, prendre une édition bilingue, et croiser plusieurs propositions.